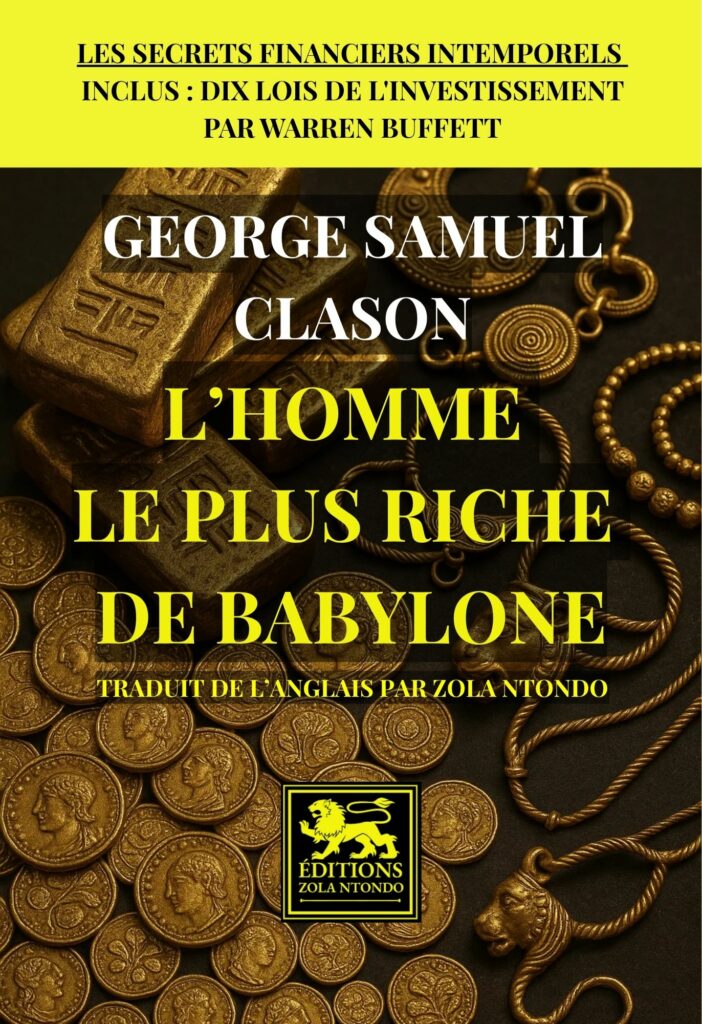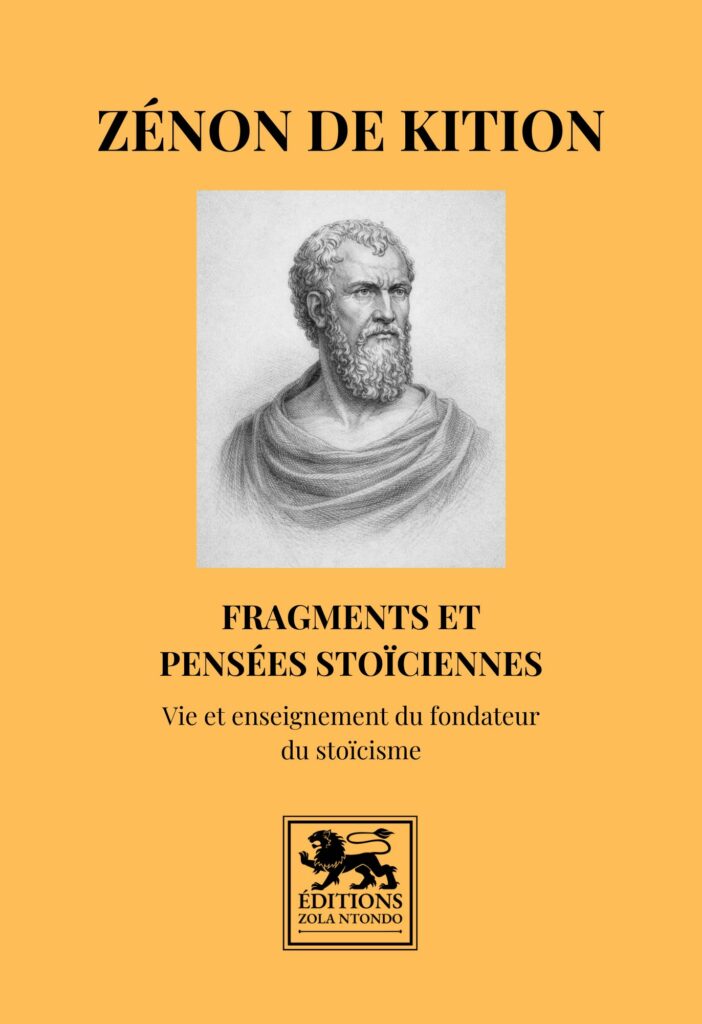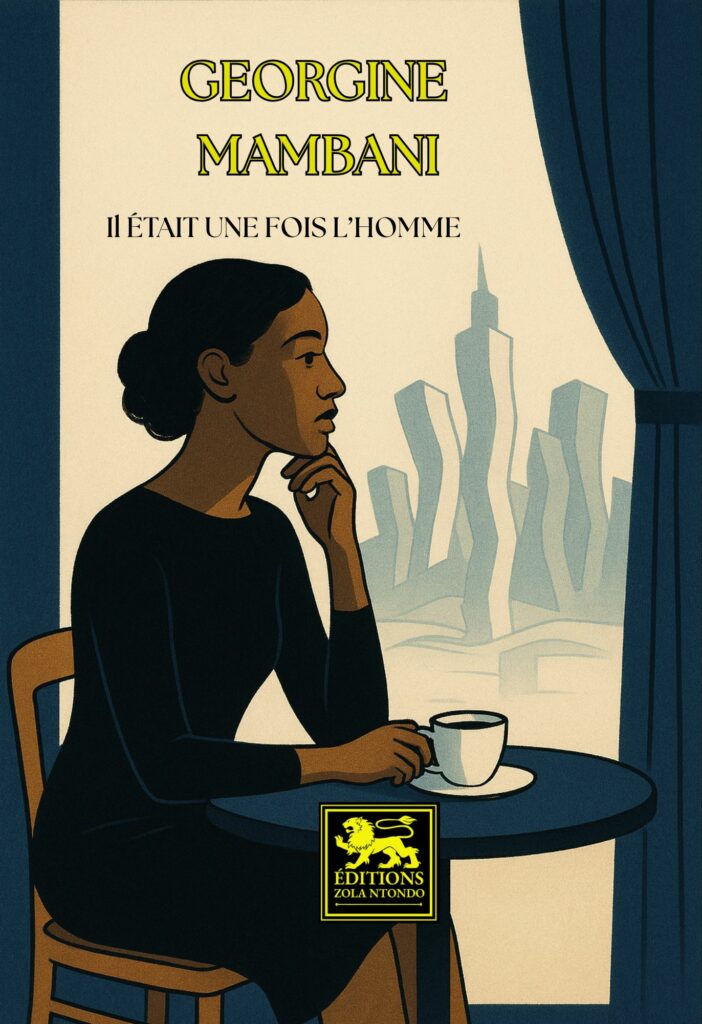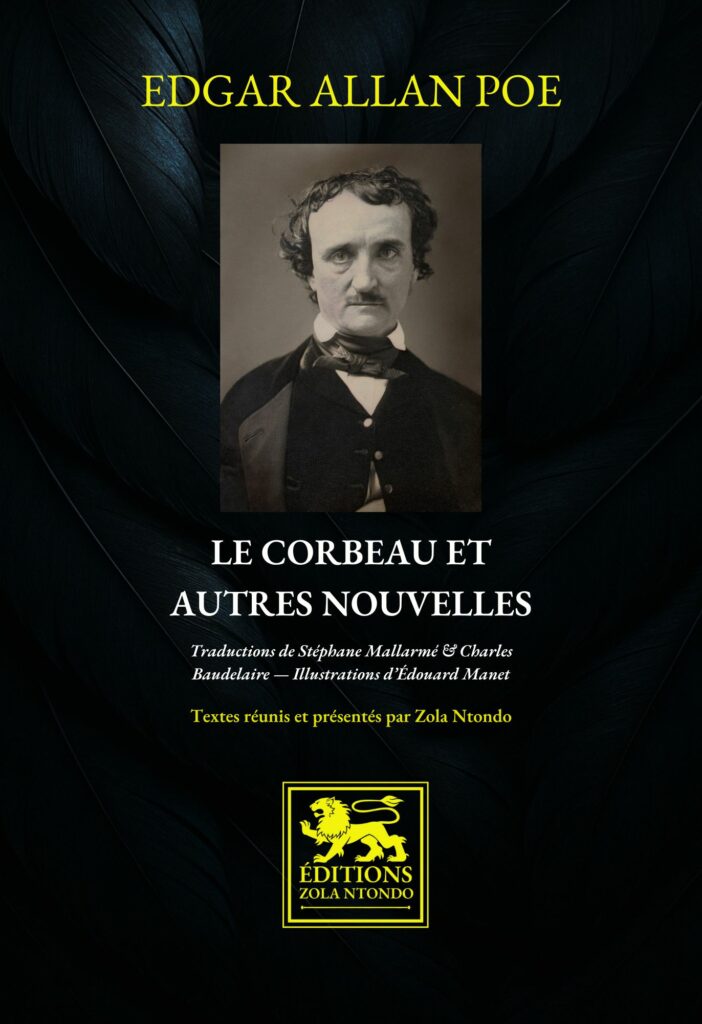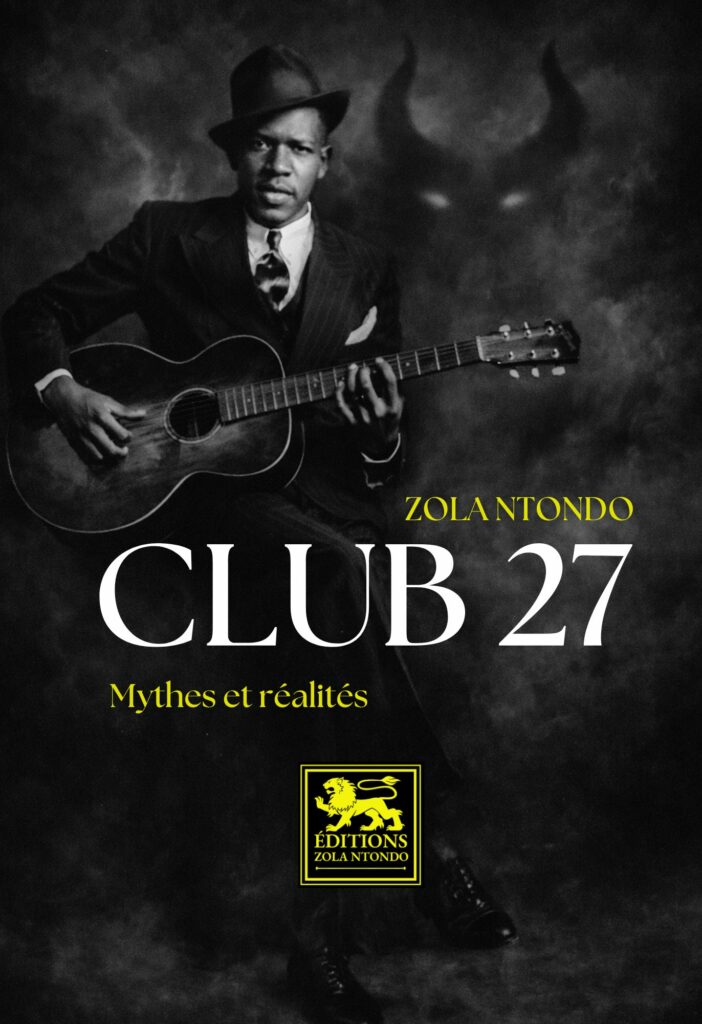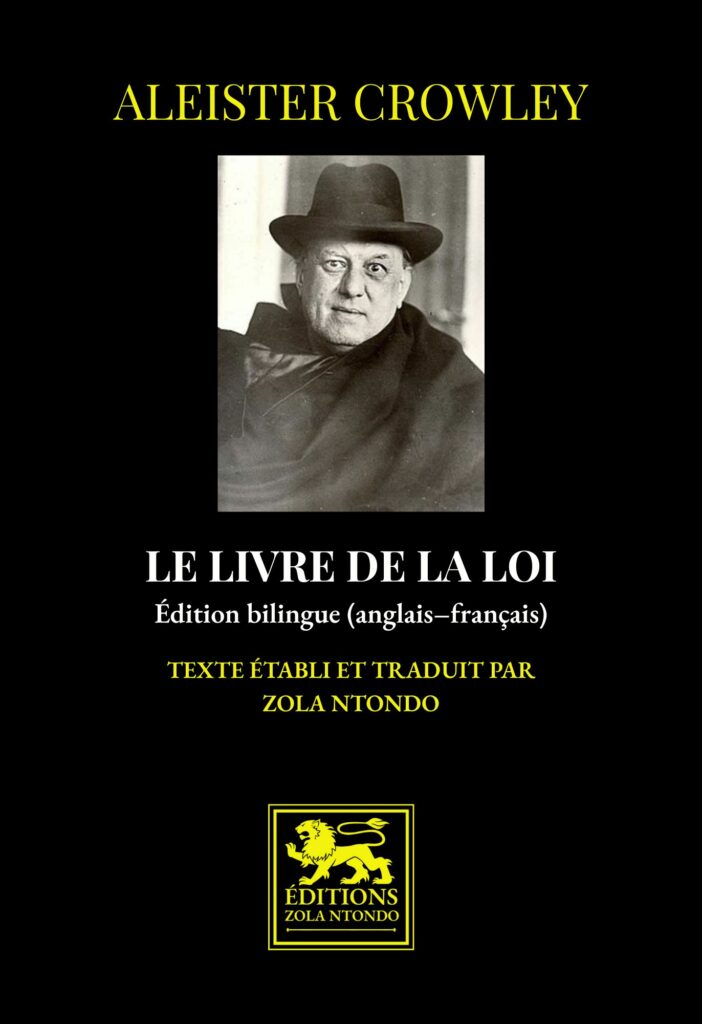La peur comme effritement du réel — Critique de Shelby Oaks (Chris Stuckmann, 2024)
Illustration : Affiche officielle. Droits réservés à leurs propriétaires.
Contexte et promesse horrifique
Avec Shelby Oaks, Chris Stuckmann signe un premier long-métrage d’horreur psychologique qui refuse d’emblée la voie facile du jumpscare à répétition.
Le film se construit autour d’une disparition : celle d’une jeune femme, figure centrale d’un ancien groupe de chasseurs de fantômes, que sa sœur n’a jamais cessé de rechercher.
Derrière ce point de départ classique se dessine une promesse : faire de l’enquête non pas un simple fil narratif, mais le révélateur d’un réel fissuré, où les images enregistrées semblent parfois en savoir plus que ceux qui les regardent.
Mythologie et archives
Le film repose sur une mythologie interne étonnamment dense : vieilles cassettes, extraits de vidéos en ligne, fragments d’émissions oubliées, traces d’un groupe occulte dont on ne sait jamais s’il relève du folklore ou du véritable danger.
Les archives mises en scène ne servent pas seulement à contextualiser l’histoire ; elles contaminent le présent, comme si chaque image passée continuait de travailler le temps et les corps.
Dans ses meilleurs moments, Shelby Oaks donne l’impression que le film lui-même est hanté par ses propres enregistrements. Les plans contemporains semblent constamment dialoguer avec ces revenants numériques, dont la texture granuleuse installe un malaise diffus.
Mise en scène et atmosphère
La mise en scène privilégie l’inquiétude lente à la frayeur instantanée. Couloirs à demi plongés dans l’ombre, pièces vides, portes entrouvertes : le film travaille le hors-champ avec une discrétion parfois très efficace.
La photographie, volontiers granuleuse, tend à effacer les contours nets pour laisser affleurer un sentiment de réalité abîmée. Les teintes ternes, les lumières faibles, les sources artificielles isolées participent d’un même geste : faire de chaque espace un lieu de doute plutôt qu’un décor spectaculaire.
Une peur qui ne surgit pas, mais qui se dépose, scène après scène, comme une poussière invisible sur le réel. Zola Ntondo sur Allociné
Le film excelle lorsque la caméra se contente de regarder : un plan fixe qui dure un peu trop, un silence que rien ne vient soulager, un détail presque imperceptible dans le cadre. C’est là que Shelby Oaks touche à une véritable qualité de hantise.
Rythme et limites de la structure
Cette matière atmosphérique se heurte toutefois à une structure parfois trop visible. Le récit progresse par blocs distincts — enquête, témoignages, archives, nouvelles pistes — comme autant de chapitres que le film ouvrirait puis refermerait trop vite.
Ce découpage a tendance à briser le vertige que l’histoire cherche à produire. La continuité de l’angoisse se trouve régulièrement interrompue par des changements de registre qui rappellent au spectateur la mécanique du scénario, là où le film gagnerait à se laisser glisser d’un état à l’autre.
La résolution, ambitieuse sur le plan thématique, arrive de manière un peu précipitée. On sent que l’univers imaginé excède la durée du long-métrage : trop d’idées, trop de strates mythologiques pour un seul film, d’où une impression de resserrement brutal au moment où le récit devrait, au contraire, respirer davantage.
Hantise, mémoire et culpabilité
Au cœur de Shelby Oaks, il y a la figure de la sœur, enfermée dans un mélange de culpabilité, d’obsession et de refus du deuil. L’horreur ne vient pas seulement des apparitions possibles, mais de cette impossibilité à accepter une disparition sans corps, sans explication définitive.
Les images deviennent alors le dernier refuge de la mémoire : on rembobine, on arrête sur un cadre, on agrandit, on cherche un signe que le monde tangible refuse de donner. Le film capte bien ce moment où la technologie, loin de rassurer, n’offre qu’une infinité de questions supplémentaires.
Dans cette perspective, les séquences les plus fortes ne sont pas forcément les plus ostensiblement horrifiques, mais celles où l’on voit la protagoniste se perdre dans ses propres interprétations, jusqu’à laisser l’angoisse envahir chaque recoin du quotidien.
Conclusion
En définitive, Shelby Oaks est un premier long-métrage d’horreur imparfait mais singulier, qui préfère l’effritement progressif du réel à la surenchère de démonstrations spectaculaires.
Ses ambitions — mythologiques, formelles, émotionnelles — dépassent parfois sa maîtrise, mais l’ensemble dégage un ton propre, une mélancolie anxieuse qui le distingue d’une grande partie de la production horrifique récente.
On en ressort avec l’impression d’avoir traversé moins une histoire qu’un état : celui d’un monde où les images ne se contentent plus d’enregistrer le passé, mais continuent de le faire revenir.
La note de Zola Ntondo : 3 sur 5 ★★★☆☆

Zola Ntondo
Éditeur en chef