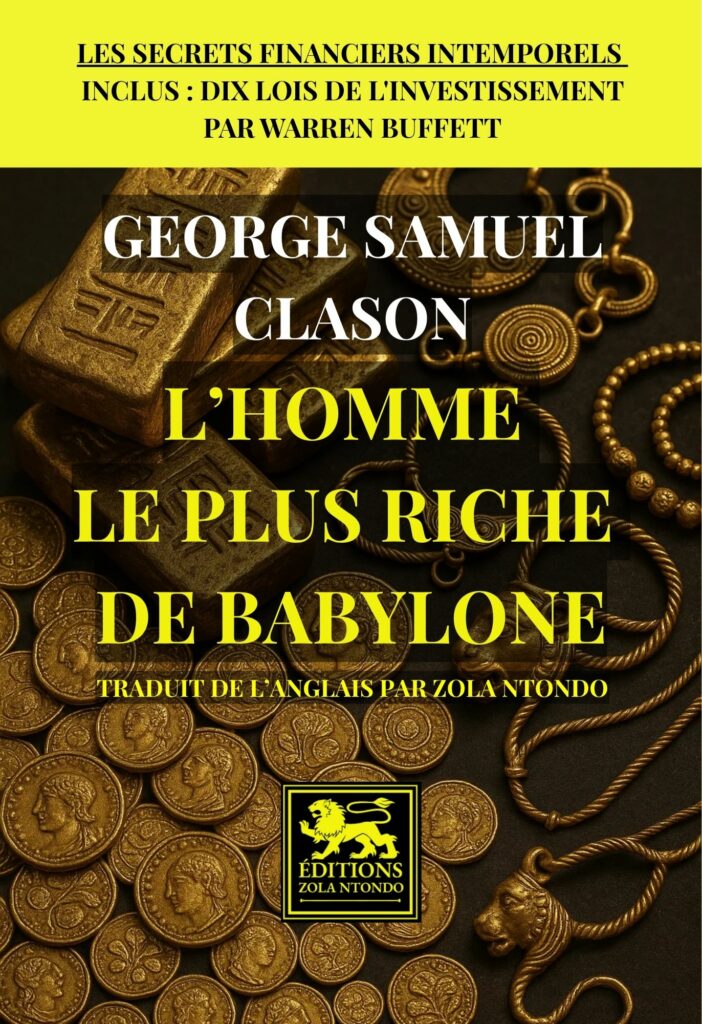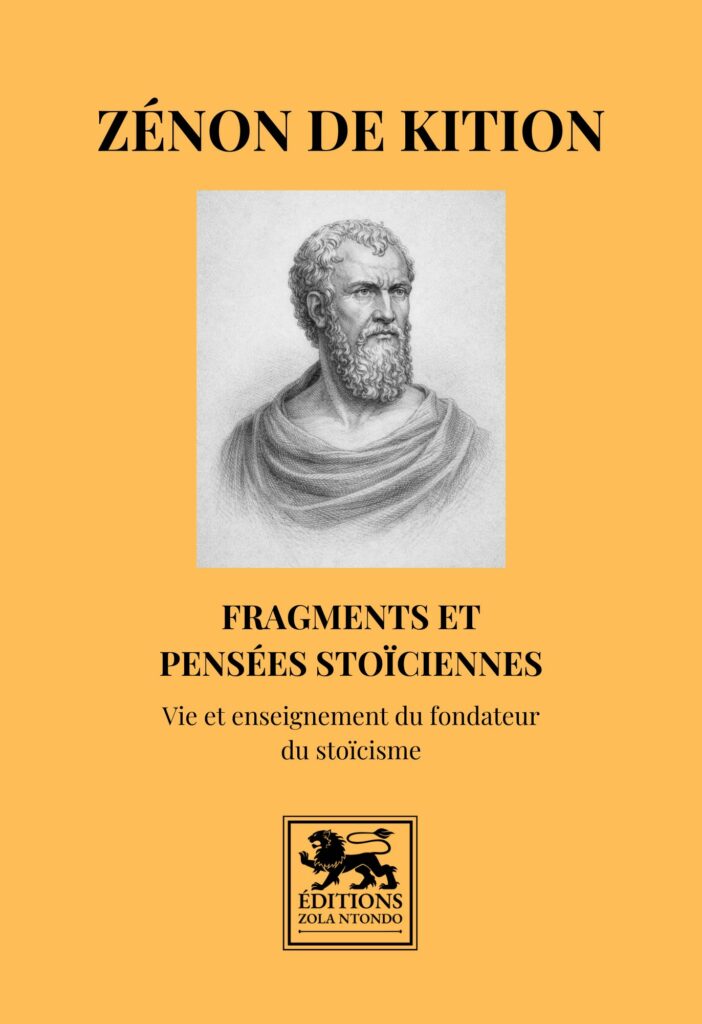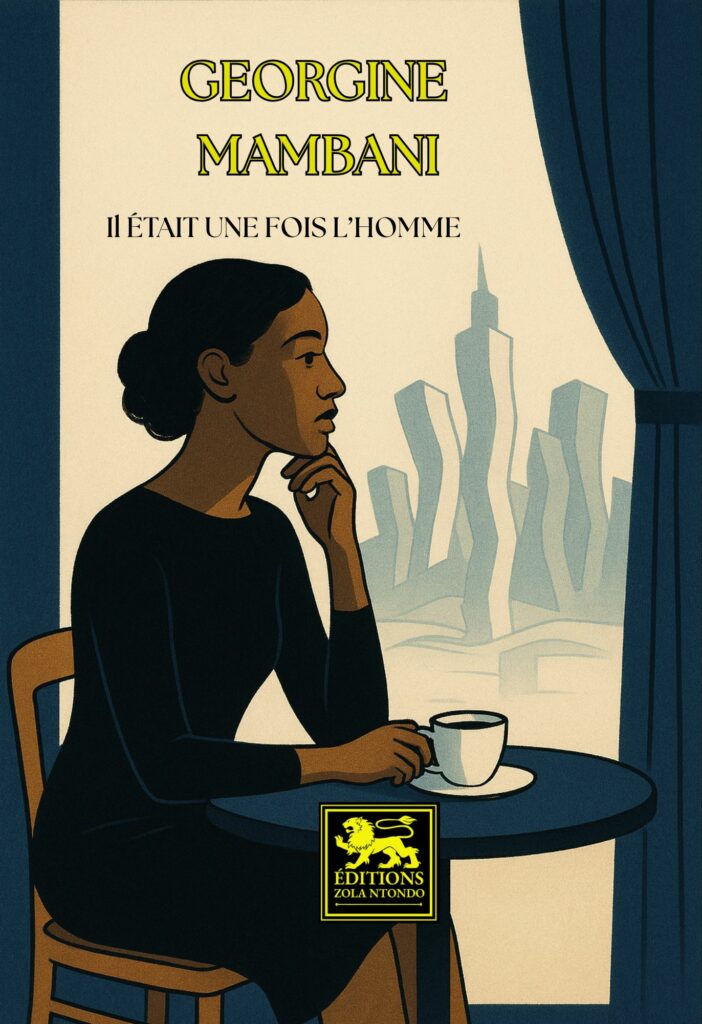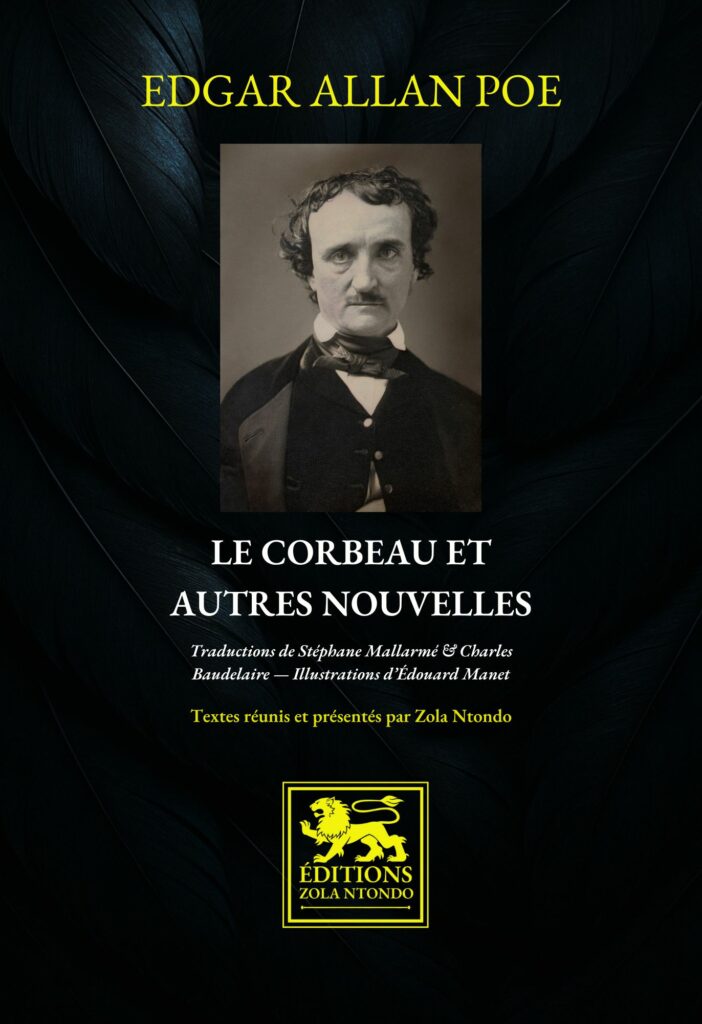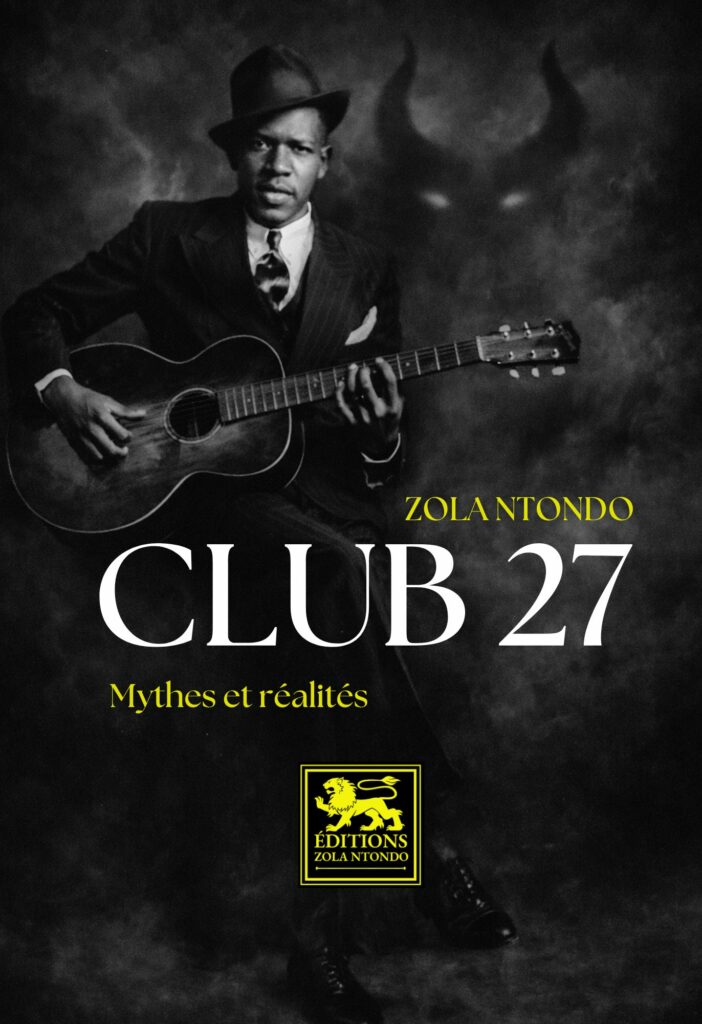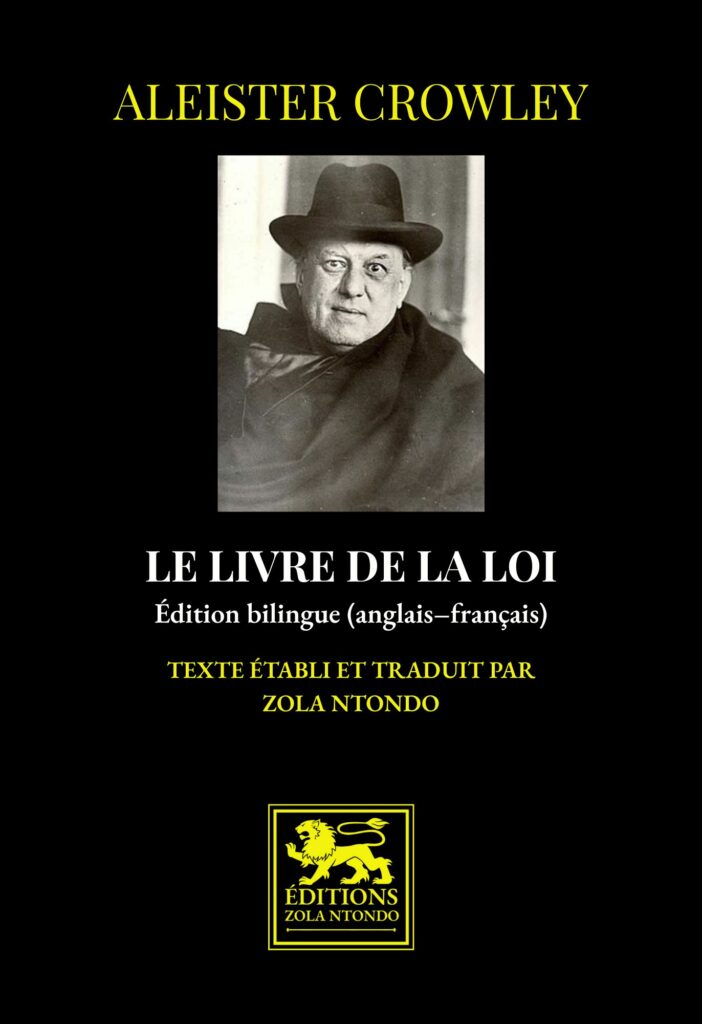Quand le foyer devient territoire — Critique de Primate (Johannes Roberts, 2026)
Illustration : Affiche officielle. Droits réservés à leurs propriétaires.
Vu en avant-première lors d’une séance Mégafrisson au Mégarama Bastide.
Un dispositif de l’horreur annoncée
Primate s’inscrit d’emblée dans une tradition narrative particulière de l’horreur : celle des récits où la menace n’est ni dissimulée ni véritablement mystérieuse, mais annoncée. À la manière de certains dispositifs policiers inversés — on pense à Columbo — le film ne fonde pas son efficacité sur la révélation, mais sur le déploiement d’un danger connu, dont l’intérêt réside dans la progression, l’attente et l’enchaînement des décisions humaines qui le rendent possible.
La question n’est jamais celle du si, mais du comment : comment une situation apparemment stable glisse vers la violence, comment les signaux sont ignorés, rationalisés ou intégrés, jusqu’à ce que l’irréversible s’impose. Primate adopte ainsi une dramaturgie de la certitude, où l’horreur naît moins de la surprise que de l’inéluctabilité.
Un slasher déplacé : la prédation sans masque
Sur le plan générique, le film peut être abordé comme un slasher déplacé. La structure d’élimination, la menace incarnée et la logique de prédation sont bien présentes, mais débarrassées de la figure humaine codifiée du tueur. Ici, la violence procède d’un être vivant, non masqué, non mythifié, dont la dangerosité ne relève pas d’une volonté maligne mais d’un instinct jamais entièrement domestiqué.
Le film se situe ainsi à la croisée du slasher et du film de créature, tout en refusant les codes spectaculaires du genre. La peur se construit moins sur l’escalade du spectaculaire que sur l’installation progressive d’une tension de proximité.
Le retour du vivant : l’animal domestiqué comme erreur de lecture
Ce positionnement résonne dans un contexte où l’horreur contemporaine a largement exploré la figure du substitut technologique. Primate opère un retour vers une angoisse plus ancienne : non pas la peur de ce que l’humain fabrique, mais celle de ce qu’il adopte, protège et projette comme inoffensif. L’animal n’est pas une menace extérieure ; il est intégré à la cellule familiale, aimé, interprété, mal compris.
Le choix du chimpanzé est déterminant. Contrairement à d’autres figures animales de l’horreur, il n’est ni naïf ni purement instinctif. Sa proximité cognitive avec l’humain, sa capacité d’apprentissage et d’adaptation brouillent la frontière entre comportement animal et intention. Cette ambiguïté nourrit un malaise durable : ce que l’on redoute n’est pas seulement la violence, mais l’idée qu’elle puisse être anticipée, comprise, et pourtant tolérée jusqu’au point de rupture.
Espace familier : quand la maison devient zone de menace
Le film inscrit son horreur dans un espace familier, domestique, quotidien. Ce choix est essentiel : il déplace la peur de l’intrusion vers la proximité, de l’extérieur vers l’intérieur. Le foyer, d’abord conçu comme lieu de protection, se reconfigure progressivement en territoire, espace de circulation, de surveillance et de prédation.
La tension naît ainsi d’un glissement : la normalité ne cède pas d’un coup, elle se dégrade, et c’est précisément cette lenteur qui rend l’angoisse plus persistante.
Photographie : une grammaire contemporaine efficace
La photographie s’inscrit dans une grammaire visuelle immédiatement reconnaissable du cinéma d’horreur contemporain : teintes froides, contrastes appuyés, découpes lumineuses qui isolent les corps dans l’espace. L’esthétique évoque une certaine efficacité “à la Blumhouse” — bien que le film ne s’y rattache pas — en ancrant la menace dans un réalisme domestique et en exploitant la lisibilité dramatique des cadres.
L’image ne recherche pas la beauté gratuite : elle organise la menace, met en place des zones de confiance apparentes et des zones d’alerte, puis laisse progressivement ces frontières se brouiller.
Musique : de l’insouciance pop à l’envahissement hypnotique
Le travail sonore constitue l’un des dispositifs les plus marquants du film. La musique repose sur une alternance construite entre deux registres : d’une part, des nappes angoissantes et hypnotiques ; d’autre part, des séquences plus pop et électro associées aux moments de convivialité, de rencontres familiales et d’insouciance apparente.
Cette alternance structure l’avancée du film et dessine une oscillation constante entre normalité et malaise latent. Puis, à mesure que l’action s’ancre et que la tension narrative se resserre, l’équilibre disparaît : les nappes envahissent l’espace sonore, absorbent les derniers îlots de légèreté, et accompagnent le basculement du récit vers un régime d’angoisse continue.
L’efficacité de cette stratégie tient à sa progression : la musique ne “souligne” pas, elle colonise, jusqu’à rendre sensible une forme d’étouffement perceptif parfaitement cohérente avec la trajectoire du film.
Conclusion
En définitive, Primate s’impose comme un film d’horreur maîtrisé et conscient de ses choix. En préférant l’attente à la surprise, la proximité à l’intrusion et l’erreur de lecture à la brutalité immédiate, il propose une horreur relationnelle où la cellule familiale et l’espace domestique deviennent les véritables lieux du danger.
Un film qui ne cherche pas à dissimuler son dispositif, mais qui trouve sa force dans la manière dont il transforme l’ordinaire en menace, et le foyer en territoire.
La note de Zola Ntondo : 4 sur 5 ★★★★☆

Zola Ntondo
Éditeur en chef