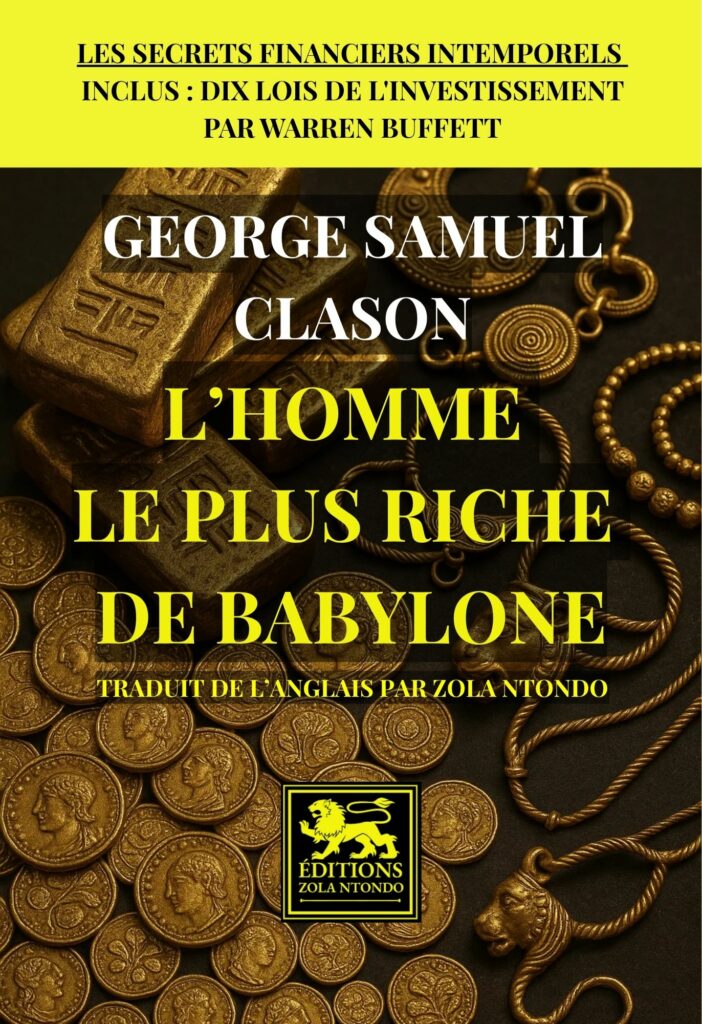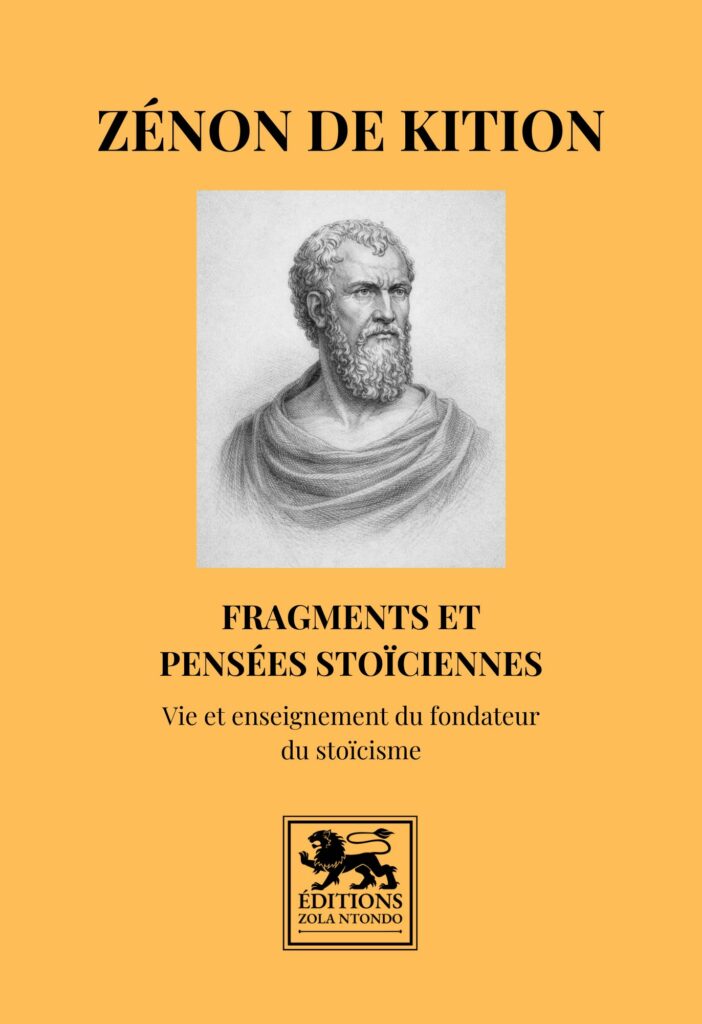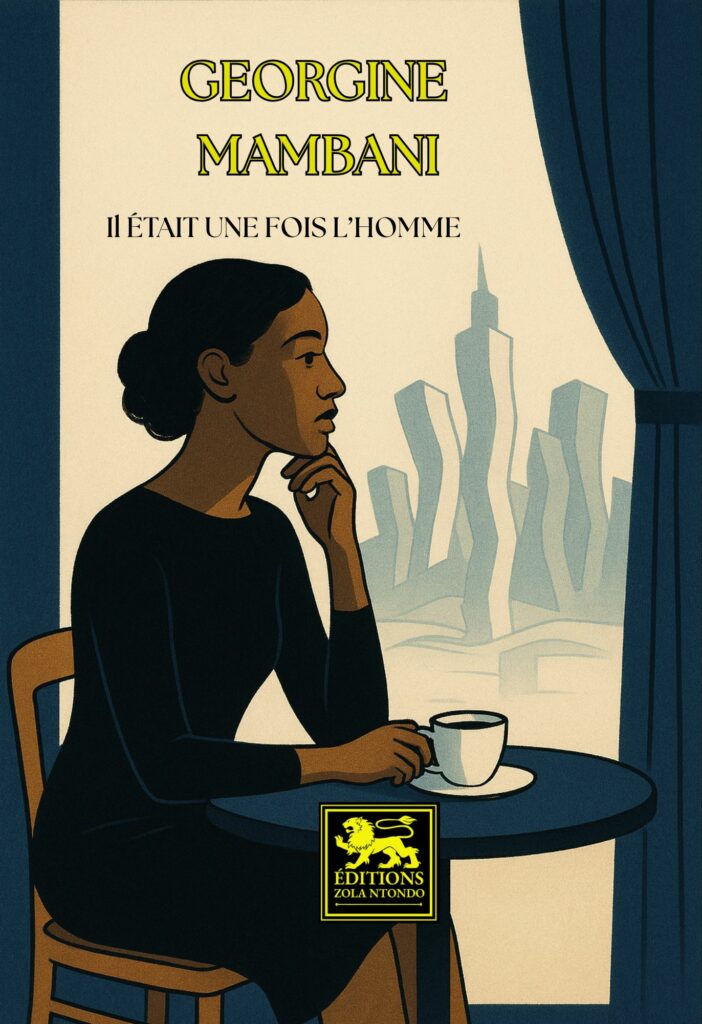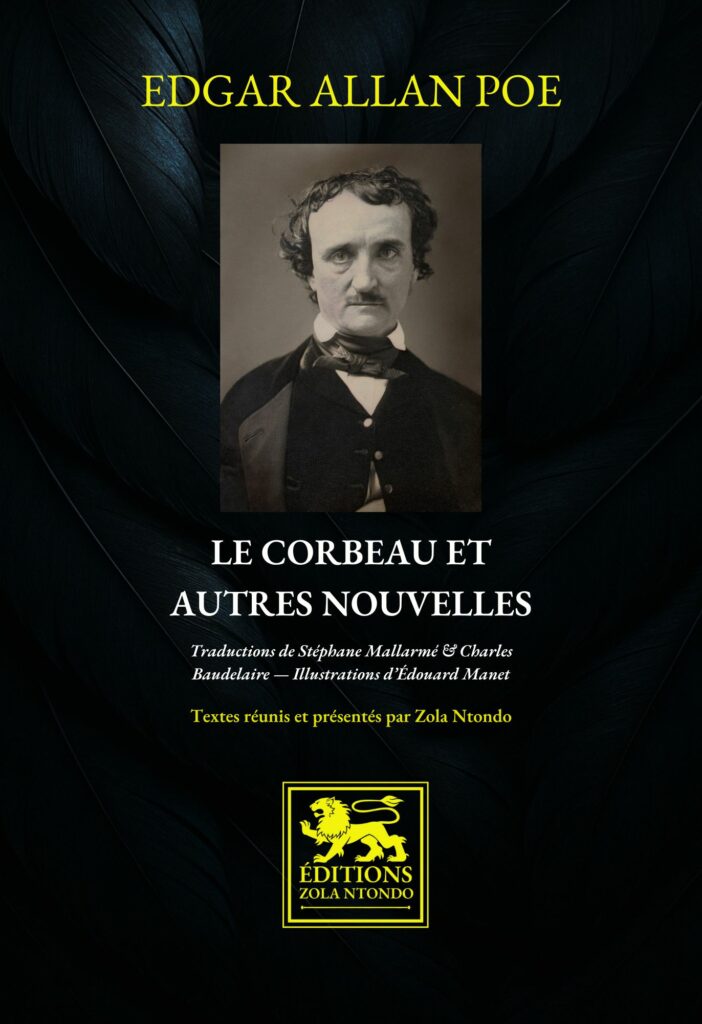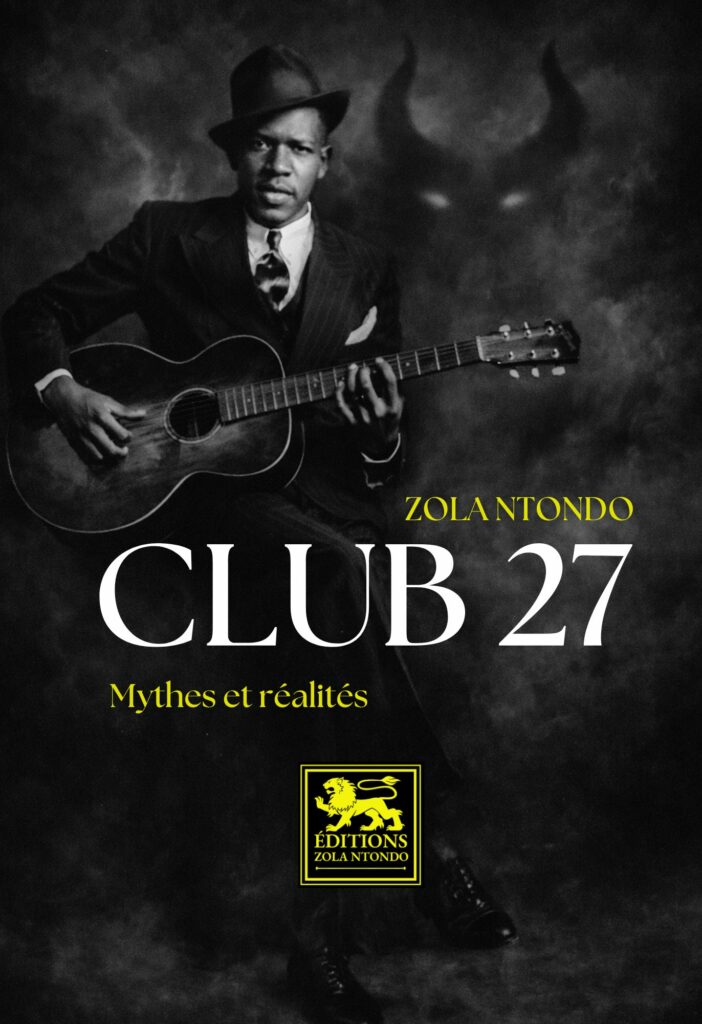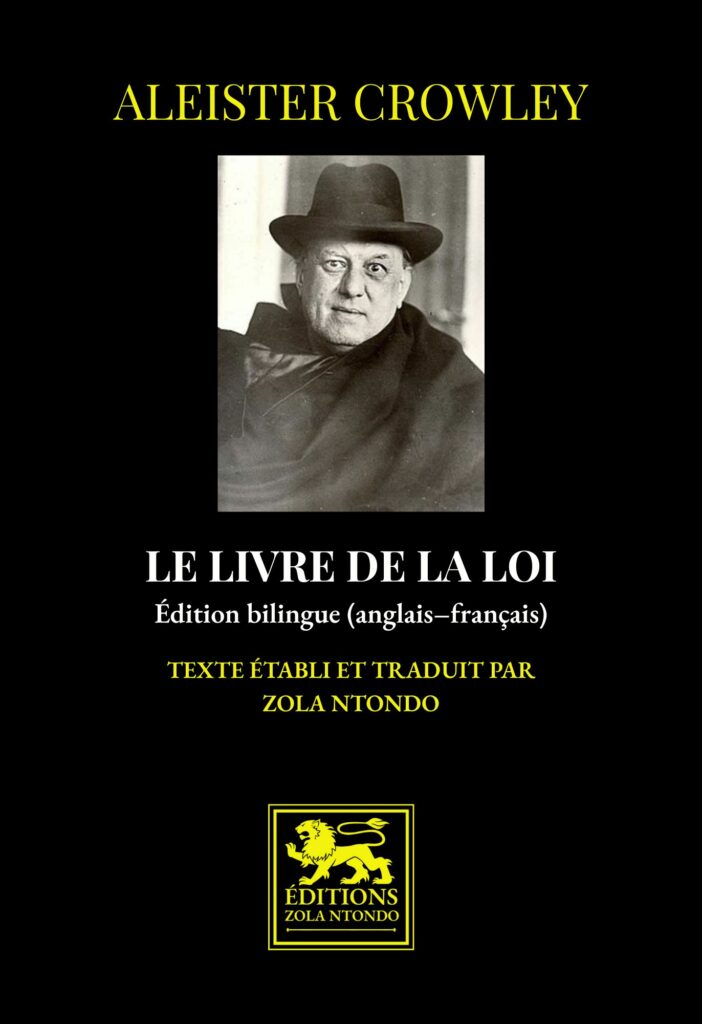L’Élue – Critique du film d’Osgood Perkins : une dérive lumineuse et putride
Illustration : Affiche du film. Droits réservés à leurs propriétaires.
Sommaire
Une ouverture qui se répand
Il arrive que certains films refusent de se dévoiler immédiatement, préférant s’infiltrer dans l’esprit du spectateur avec la lenteur des choses qui, pour durer, doivent d’abord se laisser oublier. L’Élue appartient à cette catégorie délicate où l’horreur ne s’abat pas : elle se répand, pareille à ces lumières du matin qui n’annoncent rien et colorent pourtant déjà les bords du monde.
Dès l’ouverture, le film hésite entre le visible et l’indicible. Chaque visage, chaque mur, chaque fenêtre semble moins montré que sondé. L’espace n’est jamais stable : il respire, se contracte, se relâche, comme si chaque surface abritait une rumeur ancienne prête à resurgir.
Ce chalet, apaisant en apparence, glisse imperceptiblement vers la menace. Non une menace criarde, mais un poison discret dissimulé dans la lumière même — ce manteau clair posé sur une réalité déjà fissurée.
Perkins interroge non pas le surgissement du mal, mais sa permanence. Ce qui se décompose commence toujours dans la familiarité.
L’espace du couple comme écran fissuré
Ce qui frappe d’abord dans cette critique de L’Élue, c’est la manière dont Perkins façonne l’espace conjugal : non une union stable, mais un dispositif mouvant, un rideau fragile derrière lequel une force plus ancienne se met doucement en mouvement.
L’homme, barbe grisonnante, porte dans son silence une lassitude irréfutable, comme s’il était déjà ailleurs.
La femme, portée par un désir confus d’amour et d’émancipation, avance dans un espace dont elle ignore encore que le sol s’y dérobe.
Elle croit s’ouvrir. Elle se referme.
Elle croit choisir. Elle est choisie.
Et le chalet, vaste en apparence, se fait piège. Un lieu qui semble offrir de l’air, mais qui se resserre comme un rêve qui referme doucement ses portes.
Une dissymétrie conceptuelle au cœur de la critique de L’Élue
Le film repose sur une dissymétrie fondamentale : deux imaginaires qui ne s’opposent pas frontalement, mais se frôlent, se heurtent, se contaminent.
Ce déséquilibre est le moteur secret du récit. Il ne s’agit pas de découvrir qui a raison, mais de constater que ces deux visions du monde sont vouées à s’altérer mutuellement.
Perkins orchestre ce glissement avec une subtilité presque cruelle : celui qui croit comprendre sera celui qui vacille en premier.
Une progression en spirale
Il serait vain de chercher dans L’Élue une progression linéaire. Le film ne suit pas un fil : il tourne, revient, recommence, comme un souvenir encore incapable de se recomposer.
La peur ne s’accumule pas ; elle est distillée.
Une esthétique de la rémanence
Perkins filme les visages avec une acuité presque douloureuse. Les ombres se glissent entre les traits, la lumière dépose sur chaque surface une pellicule de doute.
Le grain devient une poussière psychique, un voile qui s’élève dès que les personnages se taisent.
Le film ne cherche pas l’efficacité : il cherche la rémanence.
Une scène ne doit pas frapper. Elle doit rester.
La musique d’Edo Van Breemen : voile morbide et respiration trouble
La partition d’Edo Van Breemen n’accompagne pas : elle précède.
Elle enveloppe les images comme un voile léger dont on découvre soudain, trop tard, qu’il était en réalité une membrane dense, presque liquide.
Ses nappes, délicates et morbides, donnent l’impression d’un souffle venu d’un autre plan — irrégulier, fragile — qui transforme l’espace en organisme vivant.
Thèmes : continuité du mal, beauté trouble et résilience
Le film affirme que le mal n’appartient jamais à un événement isolé : il se perpétue, s’attarde, glisse dans les objets, les lieux, les souvenirs.
Parfois, il possède une beauté trouble, une fascination oblique.
La confiance, la résilience, tout ce que l’on tient pour lumineux devient ici une zone d’attente où quelque chose nous observe.
Conclusion
L’Élue n’est pas un film d’horreur au sens courant.
C’est un glissement, une contamination psychique, une lumière frelatée déposée sur un abîme ancien.
Un film qui s’installe comme un rêve trop clair pour être oublié et trop trouble pour être compris.
Un film qui ne cherche pas à convaincre, mais à imprégner.