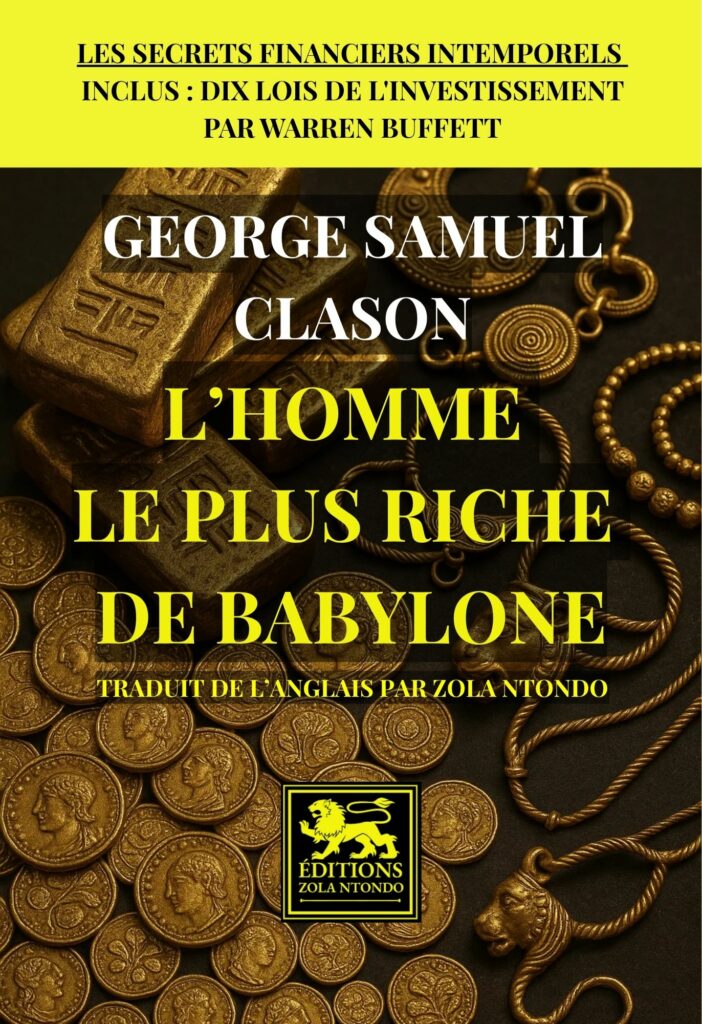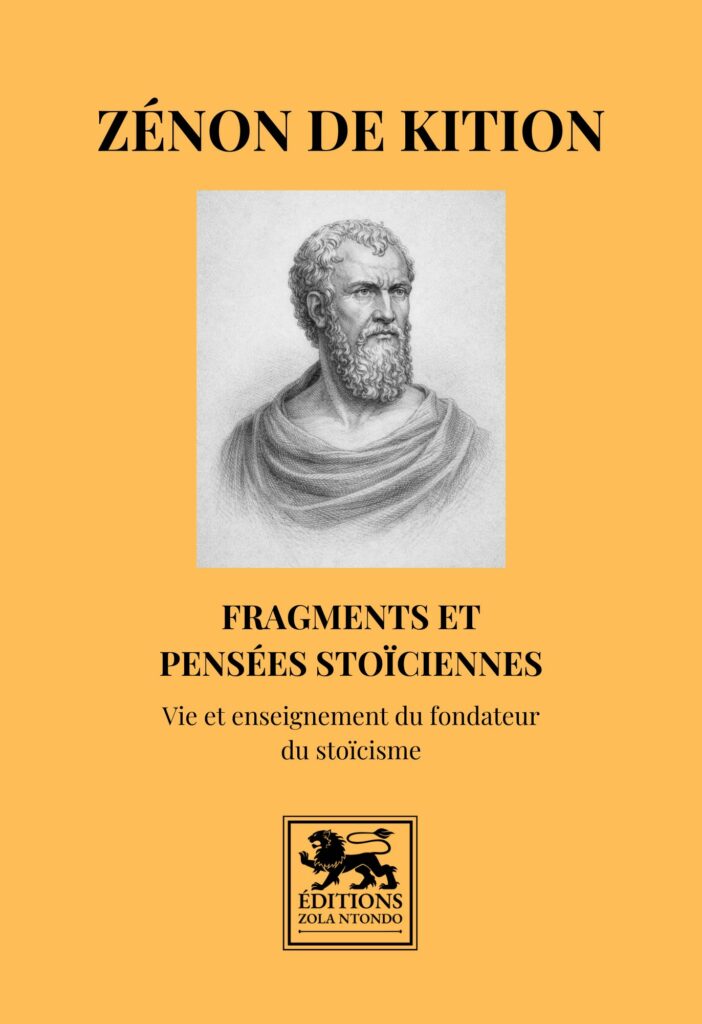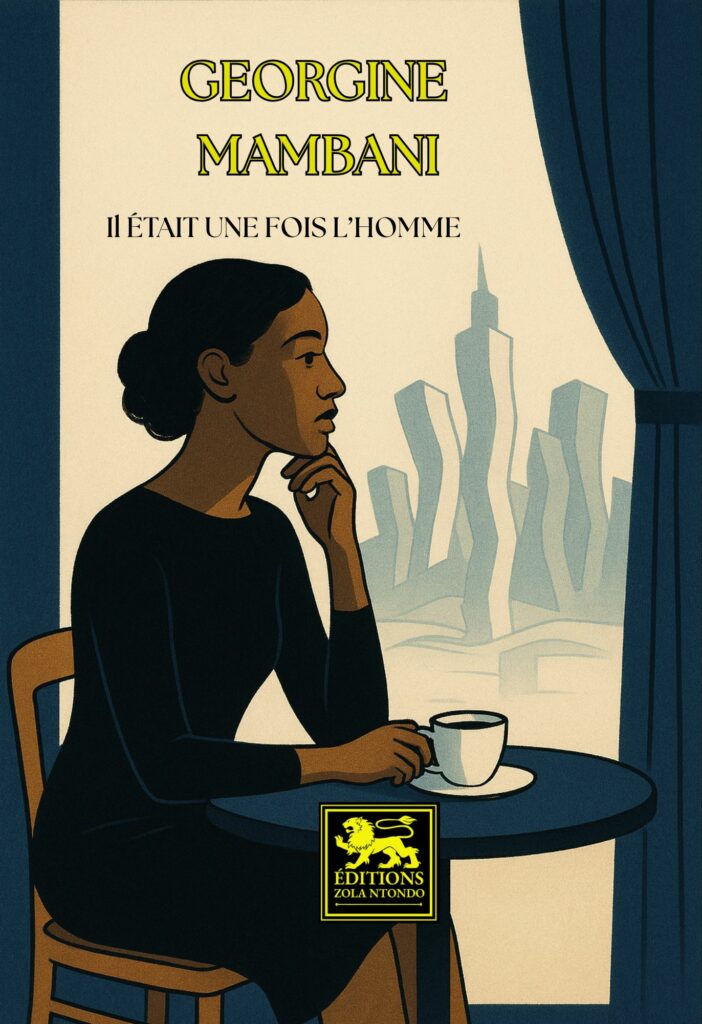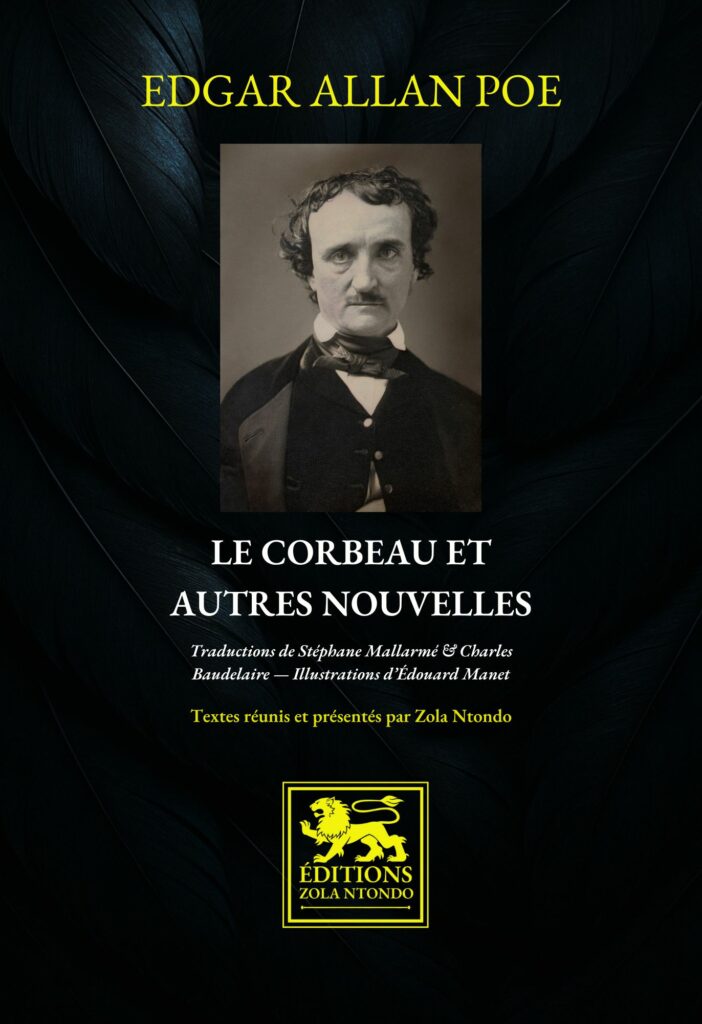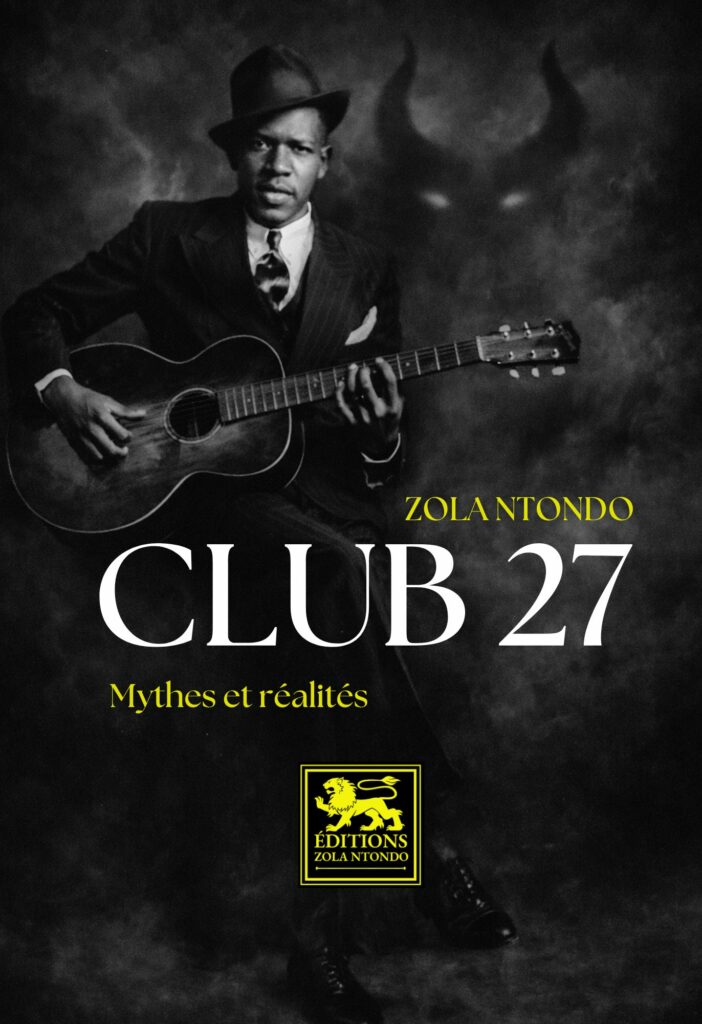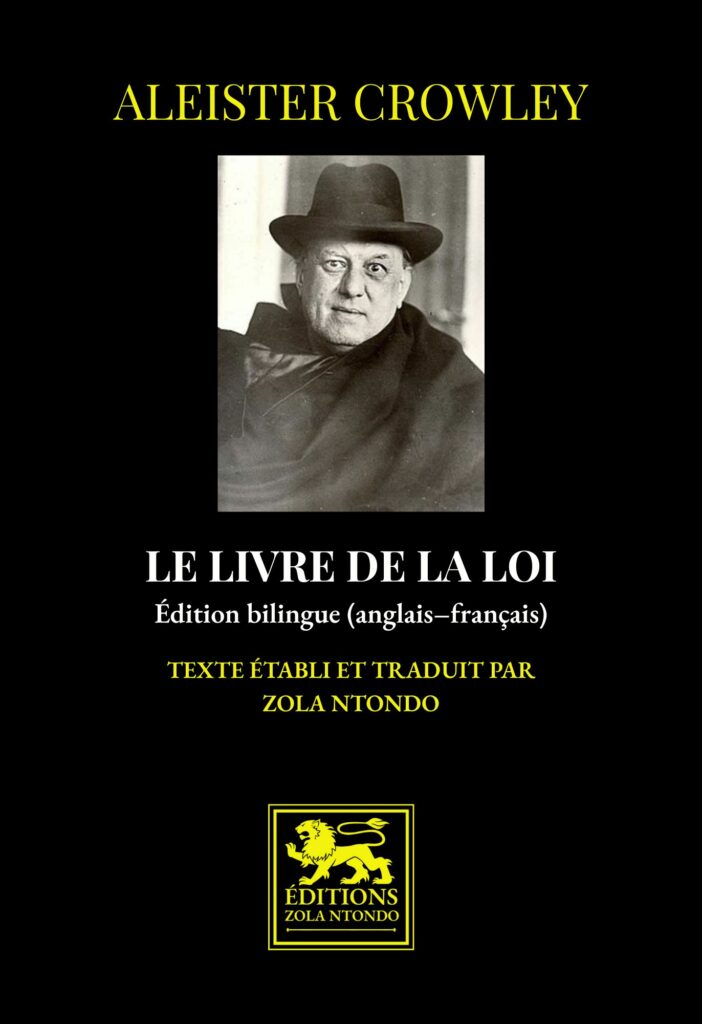L’Intermédiaire (Relay) — Critique du film
Illustration : Affiche officielle. Droits réservés à leurs propriétaires.
Une révélation d’équilibre et de maîtrise
Il arrive, très rarement, qu’un film surgisse avec cette sensation de précision absolue, d’équilibre souverain, d’évidence narrative. L’Intermédiaire (Relay) appartient à cette catégorie infime d’œuvres qui semblent déjà parfaitement à leur place dans le paysage contemporain, comme s’ils avaient anticipé nos inquiétudes, nos fuites, nos hésitations.
C’est un film d’une élégance formelle exceptionnelle : les cadres sont nets, tendus, jamais décoratifs ; chaque mouvement possède une intention ; chaque silence porte davantage que bien des dialogues. Dès les premières minutes, une certitude s’impose : nous sommes devant une œuvre qui ne cherche pas à séduire, mais qui le fait par sa seule rigueur.
Un protagoniste magnétique dans la lignée de Rami Malek
Et il y a ce personnage principal — magnétique, énigmatique, presque translucide, et pourtant pesant comme une ombre dans chaque scène.
Il évoque immédiatement la lignée inaugurée par Rami Malek : une intériorité dense, une tension contenue, une fragilité muette qui se transforme en arme.
Il avance comme Malek avance : avec cette impression de brûlure invisible, de pensée souterraine, d’émotions qui ne se montrent pas mais qui modèlent l’air autour de lui.
Une présence qui agit sans dire, une force silencieuse qui impose sa gravité.
Deux personnages centraux superbement écrits
Mais Relay ne repose pas sur lui seul.
Le film trouve sa profondeur dans la finesse d’écriture des deux personnages centraux, construits comme deux lignes mélodiques qui se croisent, se répondent, se déforment l’une au contact de l’autre.
Leurs arcs narratifs respectifs sont parmi les plus subtils vus récemment : deux trajectoires qui avancent par glissements imperceptibles, gestes minuscules, ruptures étouffées.
Chez l’un, une lucidité qui s’éveille, douloureuse mais nette.
Chez l’autre, une prise de pouvoir intérieure, trouble, presque hypnotique.
Aucun ne se transforme brutalement : ils adviennent, lentement, comme si la rencontre elle-même les modifiait à leur insu.
L’écriture, par sa précision, devient émotion pure.
Il avance comme Malek avance : avec cette impression de brûlure invisible, de pensée souterraine, d’émotions qui ne se montrent pas mais qui modèlent l’air autour de lui. Zola Ntondo sur Allociné
Une ouverture musicale oppressante et maîtrisée
Et puis, il y a la musique.
Dès la première seconde, la partition de Tony Doogan impose une présence que l’on ne peut ignorer.
La musique ne se contente pas d’accompagner : elle devance le film, elle s’avance devant lui comme une ombre sonore, un souffle resserré qui cerne le spectateur avant même que les images n’aient trouvé leur stabilité.
Cette ouverture est oppressante, mais d’une oppression élégante, presque cérémonielle.
Tony Doogan : synthétiseurs, tension et héritage 70–80
Doogan utilise des synthétiseurs dont la texture évoque immédiatement une filiation :
une nervosité tendue, une pulsation retenue, un halo sonore qui rappelle à la fois le climat mélancolique de la musique électronique des années 70 et certains agencements synthétiques de Giorgio Moroder pour Midnight Express — non dans la flamboyance, mais dans la gravité suspendue, dans cette manière qu’avait Moroder d’installer une tension horizontale, continue, presque respiratoire.
Ici, pas d’arpèges triomphants :
plutôt une nappe qui avance, une poussée sourde qui semble courir sous le film, une mémoire anticipée de ce que le récit n’a pas encore révélé.
Puis, au fil du film, cette musique quitte l’oppression inaugurale pour devenir une respiration intérieure, un murmure qui accompagne la dérive des personnages, comme une conscience parallèle qui se souvient à leur place.
Une architecture narrative d’une précision rare
Ce qui impressionne ensuite, c’est l’intelligence narrative.
Relay ne déroule pas une histoire : il construit une architecture mentale, un espace où la tension sociale, le mensonge, l’ambition et la contorsion morale deviennent les ressorts d’un labyrinthe parfaitement ordonné.
On avance dans le film comme dans un puzzle où chaque pièce, révélée au moment exact, modifie le sens de tout ce qui précède.
Les performances sont d’une justesse rare.
Il ne s’agit pas d’interpréter, mais d’habiter un système.
Les acteurs épousent le moindre pli de l’écriture, comme s’ils respiraient au même rythme que le film.
Tout semble naturel, fluide, inévitable.
Une mise en scène d’une virtuosité invisible
La mise en scène, elle, brille par une maîtrise presque invisible.
Il y a dans Relay ce paradoxe magnifique : une virtuosité que l’on ne remarque qu’après coup, lorsque l’on réalise que chaque image portait déjà la promesse de la suivante.
La progression dramatique est implacable, mais jamais brutale.
Un étau qui se resserre avec une douceur inquiétante.
Et puis, il y a ce regard sur les relations humaines : ce flux constant des manipulations, des ambitions, des stratégies minuscules qui tissent nos vies.
Relay montre sans appuyer, révèle sans dénoncer, observe sans moraliser.
Le film excelle dans cette alchimie rare :
complexité dramaturgique + clarté émotionnelle.
Chaque scène devient un palier vers une résolution qui, lorsqu’elle arrive, semble à la fois surprenante et absolument juste.
Un film nécessaire : lucide, maîtrisé, inoubliable
L’Intermédiaire (Relay) ne se contente pas d’être une réussite.
C’est un film nécessaire, droit, lucide, construit avec une maîtrise qui force l’admiration.
Un accomplissement.
Une démonstration.
Un chef-d’œuvre discret — et pour cette raison même, inoubliable.
La note de Zola Ntondo : 5 sur 5 ★★★★★

Zola Ntondo
Éditeur en chef