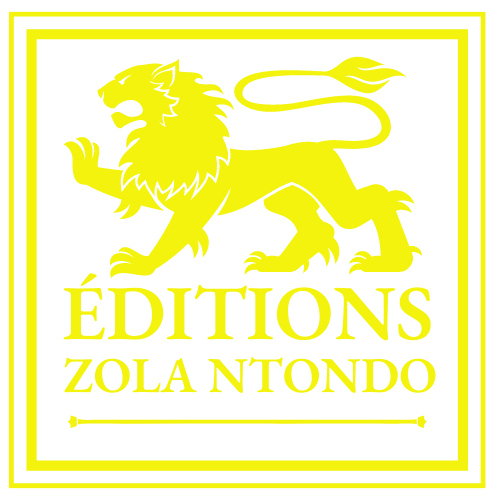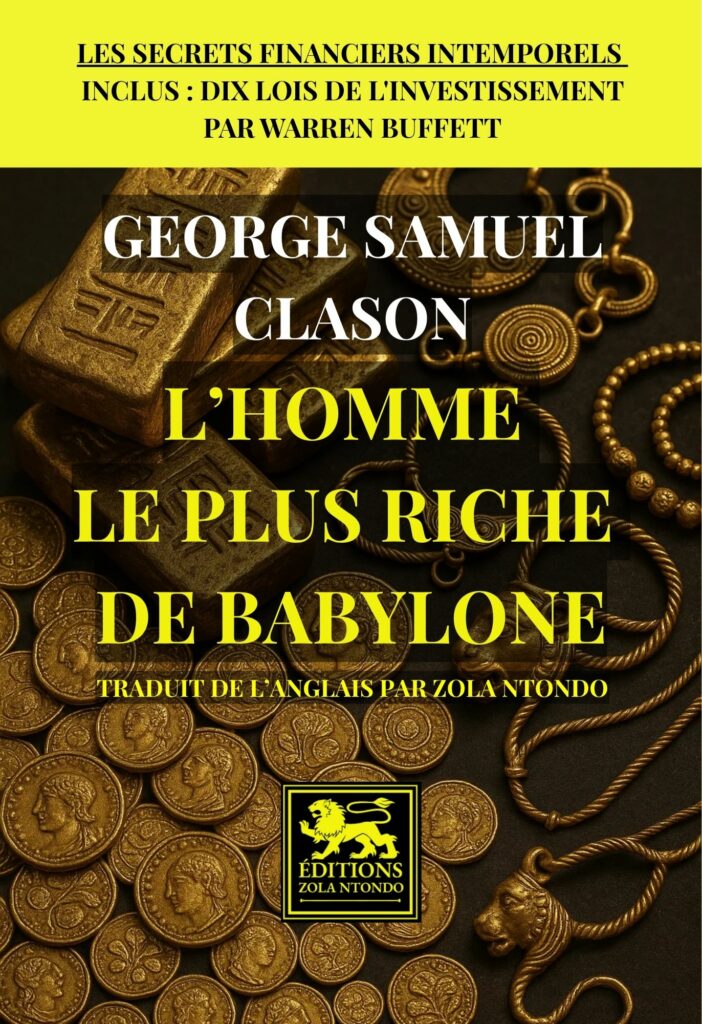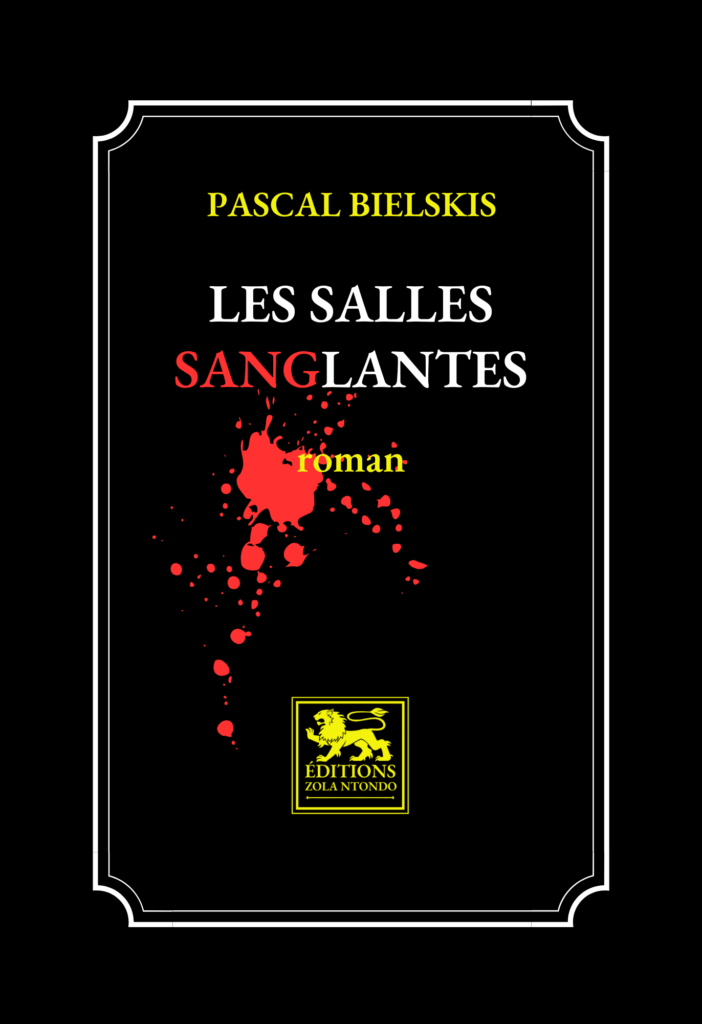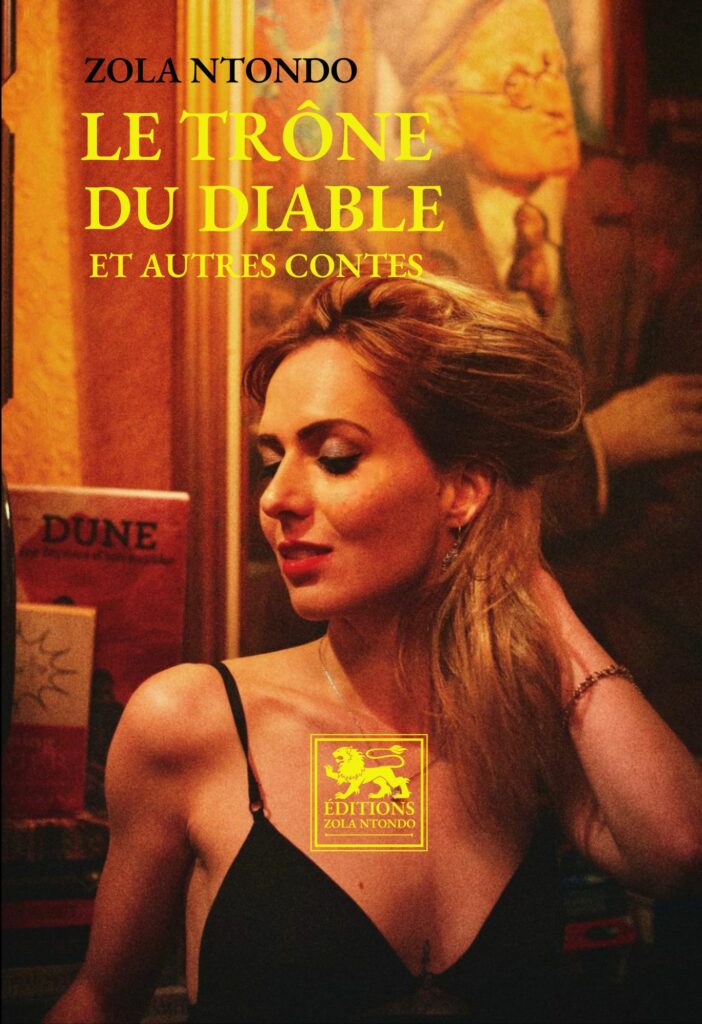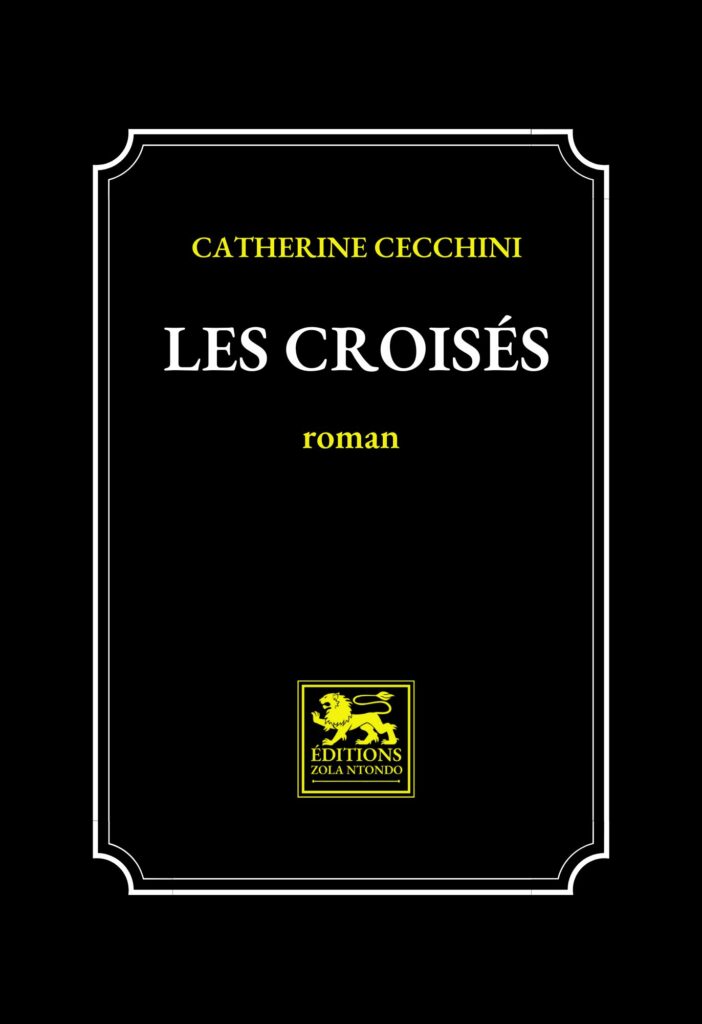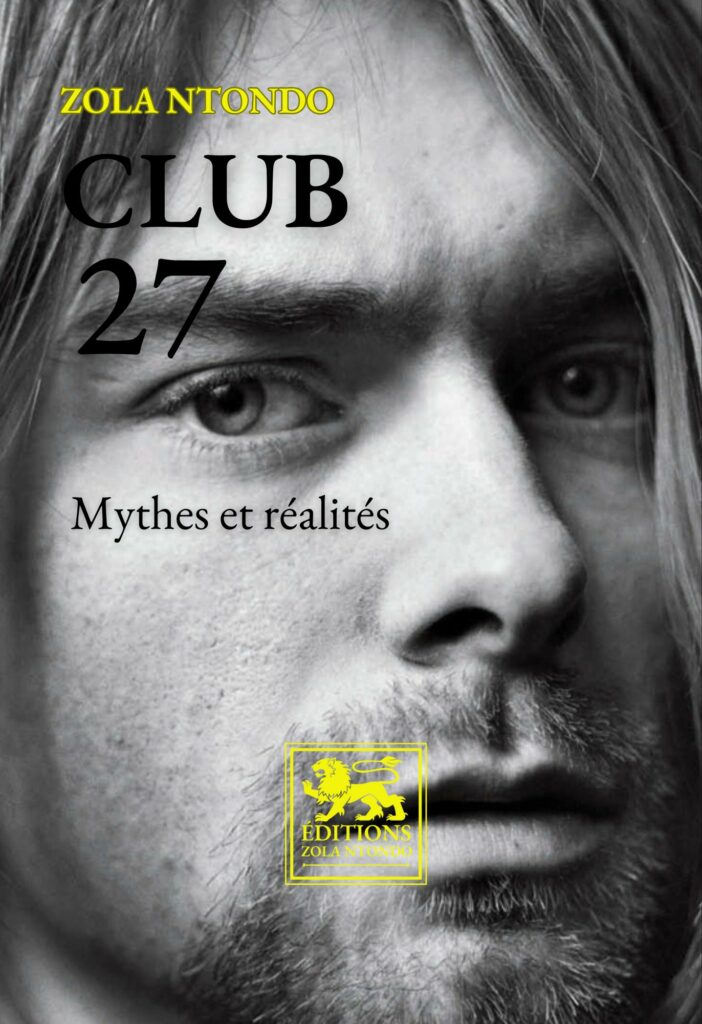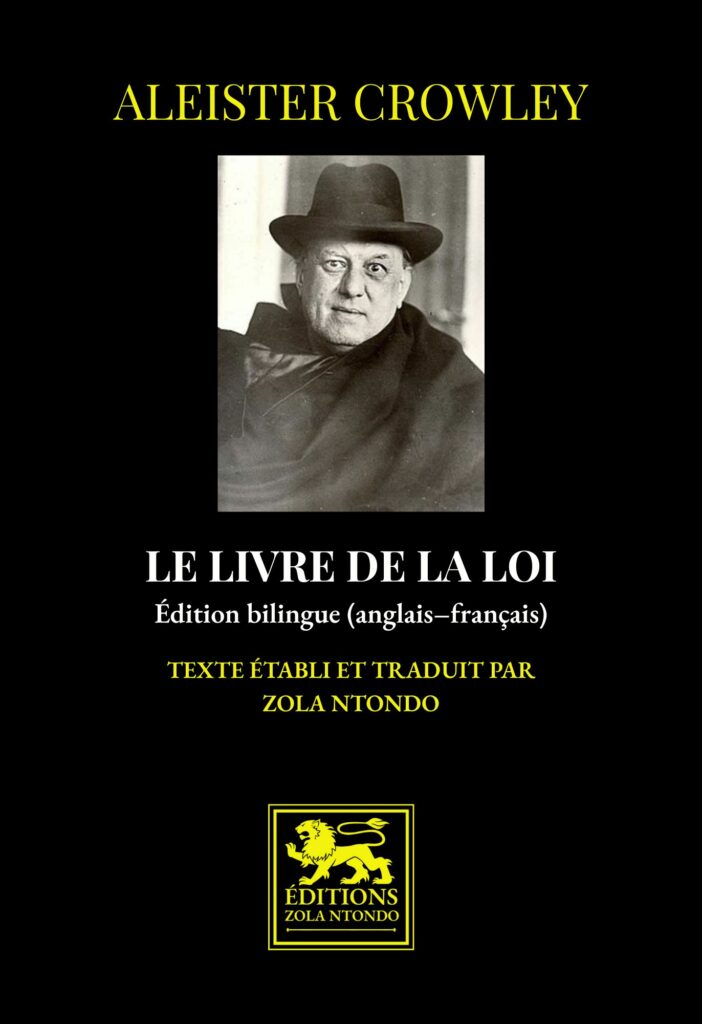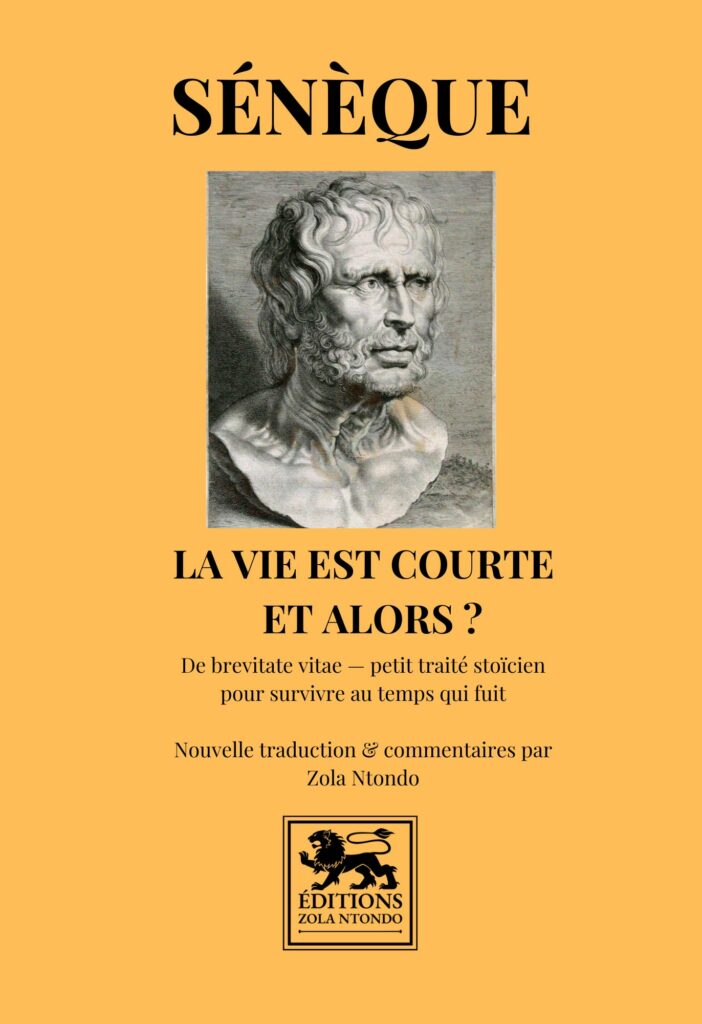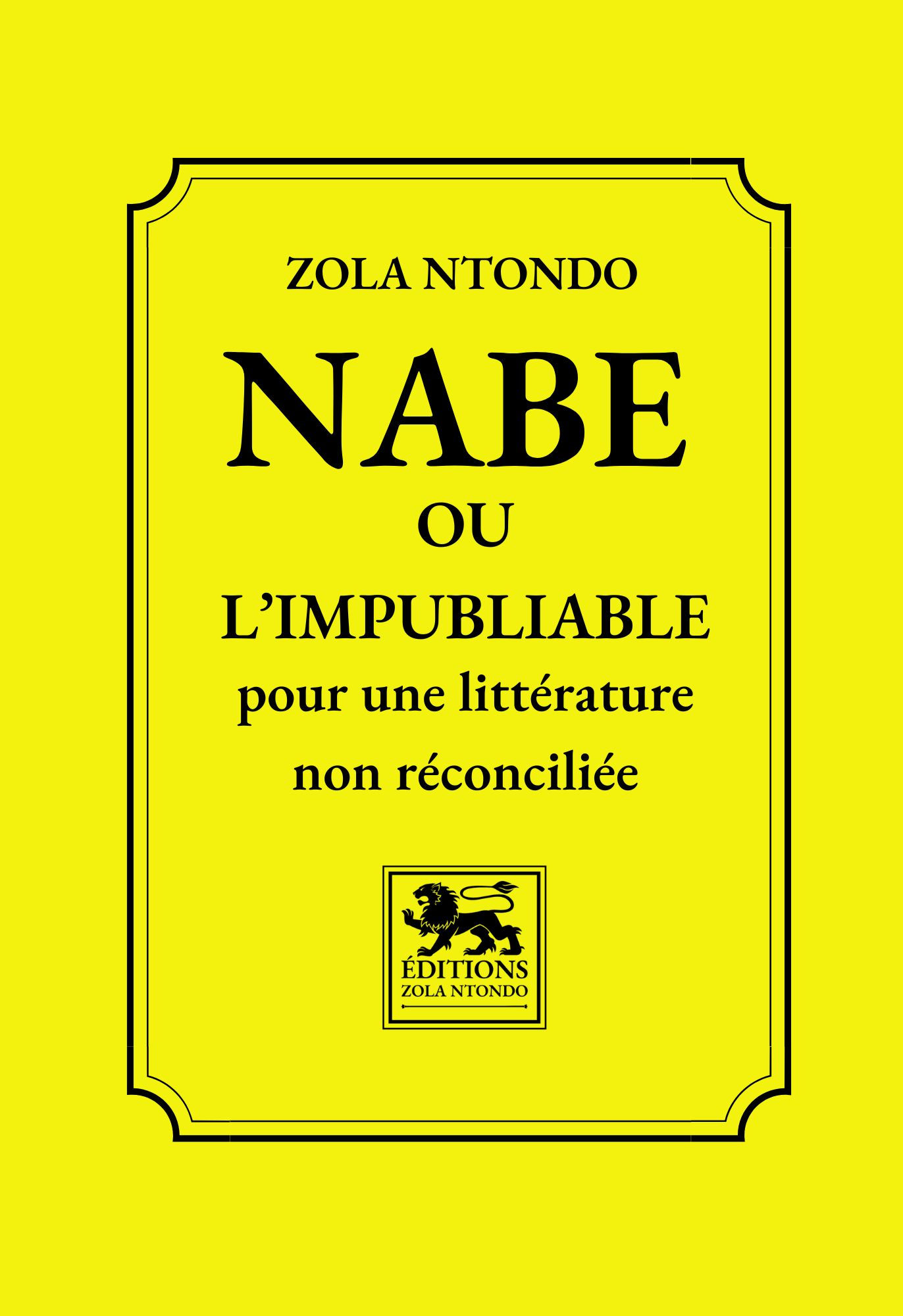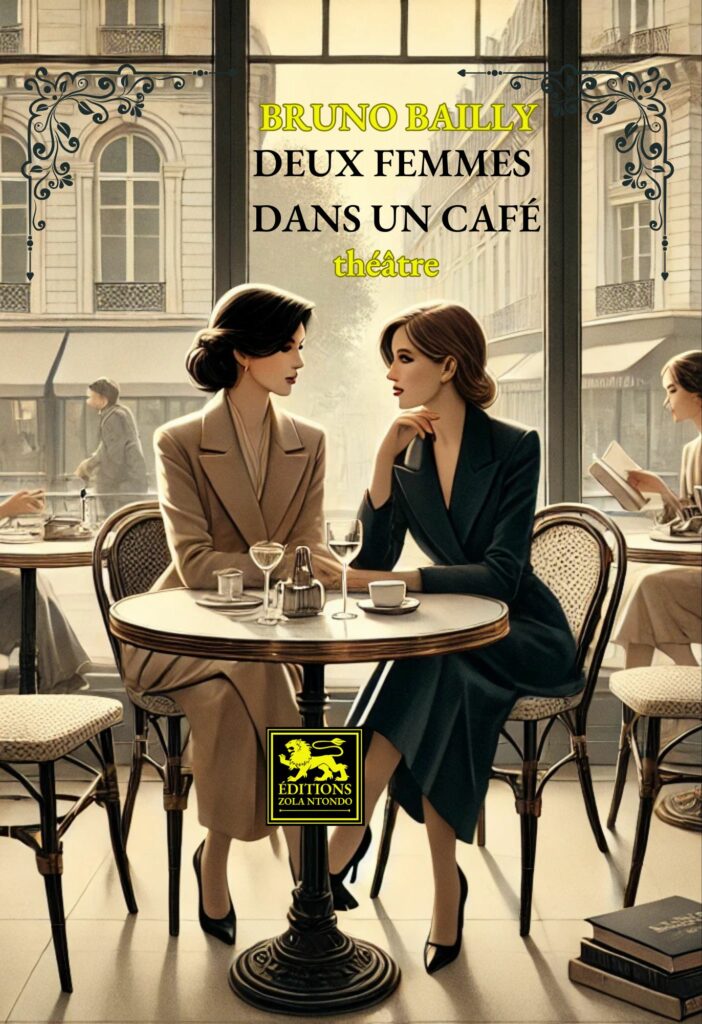Quand The Conjuring 4 vire au chaos : l’horreur hors de l’écran
Sommaire :
Le cinéma d’horreur en France reste marginalisé. On le dit réservé à une poignée d’initiés, trop “populaire” pour l’élite culturelle, trop risqué pour les distributeurs. Pourtant, à chaque sortie d’un grand titre, la réalité contredit ce cliché : les salles se remplissent, l’attente est palpable, et l’expérience devient un événement collectif.
Succès et débordements
La sortie de The Conjuring : L’heure du jugement en septembre 2025 a confirmé la popularité du film d’horreur en France. Avant-premières bondées, salles pleines : le public était au rendez-vous. Mais derrière ce succès, un phénomène inquiétant a émergé. Dans plusieurs villes, certaines projections ont dégénéré en bagarres, forçant parfois à interrompre la séance.
Deux publics opposés
La salle de cinéma devient alors un lieu de confrontation. D’un côté, les spectateurs réguliers, attachés à l’expérience immersive et au silence collectif. De l’autre, des spectateurs occasionnels, pour qui la séance est une rare sortie festive, vécue comme un défouloir. L’affrontement de ces deux logiques crée un climat tendu où la moindre provocation peut dégénérer.
La psychologie de l’incivilité
La peur agit comme un révélateur de comportements. Face à une mise en danger symbolique — celle provoquée par l’horreur — chacun cherche une stratégie de contrôle :
- Le spectateur immersif accepte la peur, se tait, vit l’expérience.
- Le spectateur défensif refuse d’être vu comme vulnérable. Son rire forcé, ses commentaires bruyants ou ses provocations sont autant de moyens de reprendre la main.
- Le spectateur revendicatif transforme la séance en scène sociale. Il veut se montrer plus fort que le film et plus visible que les autres spectateurs. Dans un groupe, ce rôle s’amplifie, chaque geste cherchant à surenchérir sur le précédent.
- L’incivil “par réaction” ne cherchait pas à troubler la séance, mais excédé par ces comportements, il réagit violemment, et le conflit éclate.
Dans cette logique, la bagarre n’est pas un accident extérieur au film : elle est l’aboutissement d’un mécanisme de défense mal maîtrisé, où l’incapacité à se laisser traverser par la peur se traduit par la confrontation.
Le facteur social
Ces débordements ne relèvent pas d’une question ethnique, comme le suggèrent certains discours simplistes. Ils traduisent plutôt :
- un manque d’habitude des codes de la salle,
- un besoin de prouver sa place dans le groupe,
- un décalage générationnel (habitude du streaming individuel vs rituel collectif de la salle).
Selon le lieu, la perception change : un public bordelais, habitué à une offre culturelle diversifiée, adopte plus facilement des comportements policés qu’un public d’une ville où le multiplexe constitue l’unique espace de socialisation.
Le dilemme des cinémas
Pour les exploitants, l’équation est délicate. Les films d’horreur ne remplissent pas toujours les salles, mais certains titres phares comme The Conjuring 4 attirent massivement. Ces succès ponctuels prouvent que le public existe, mais ils s’accompagnent parfois d’incivilités qui dégradent l’expérience. Au lieu d’unir les spectateurs autour d’une peur partagée, l’horreur peut alors devenir le catalyseur de tensions et de divisions.
Incivilités et désaffection
On explique souvent la baisse de fréquentation des salles par le prix du billet, la concurrence du streaming ou la multiplication des écrans personnels. Mais les incivilités jouent un rôle tout aussi important. Dans les séances bondées, elles explosent ; dans les séances réduites, elles subsistent encore. Pour certains spectateurs, la peur ne vient plus du film d’horreur, mais du risque de vivre une mauvaise expérience au cinéma.

Zola Ntondo
Éditeur en chef