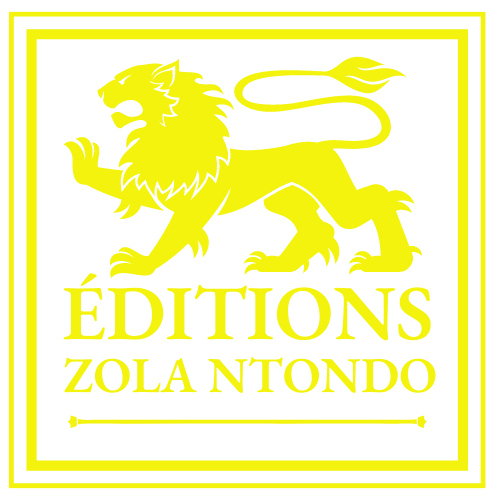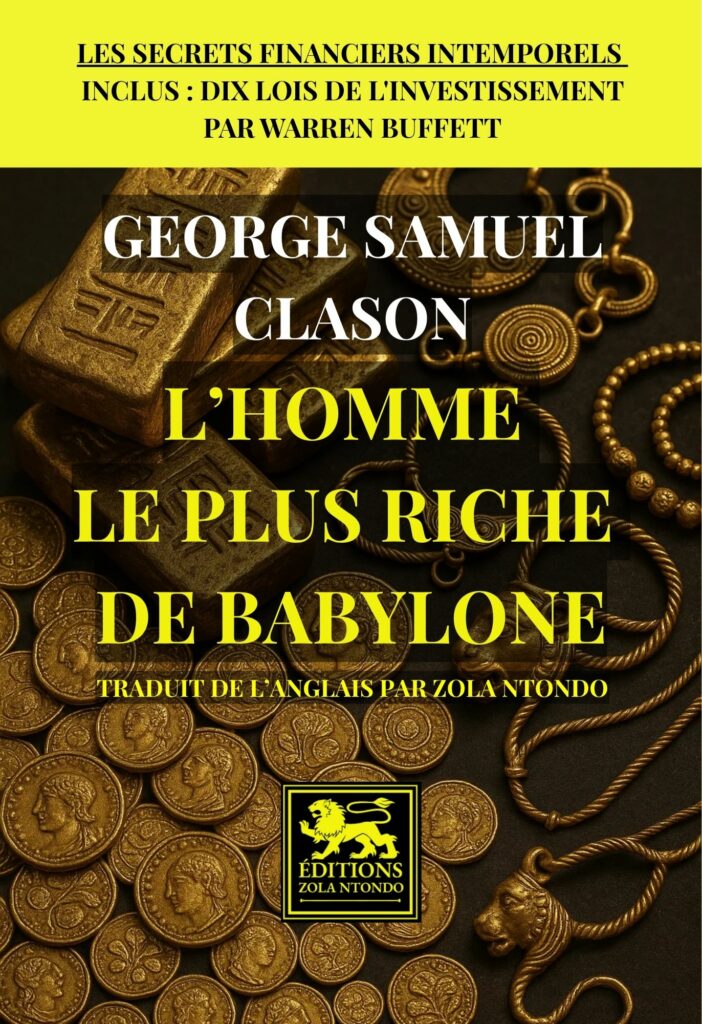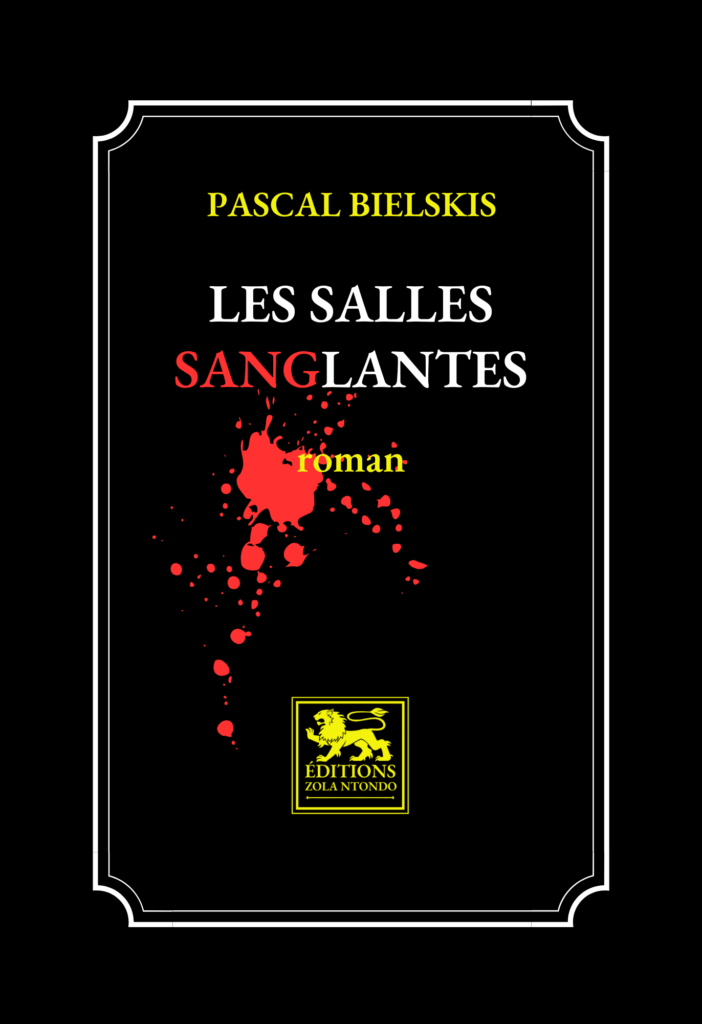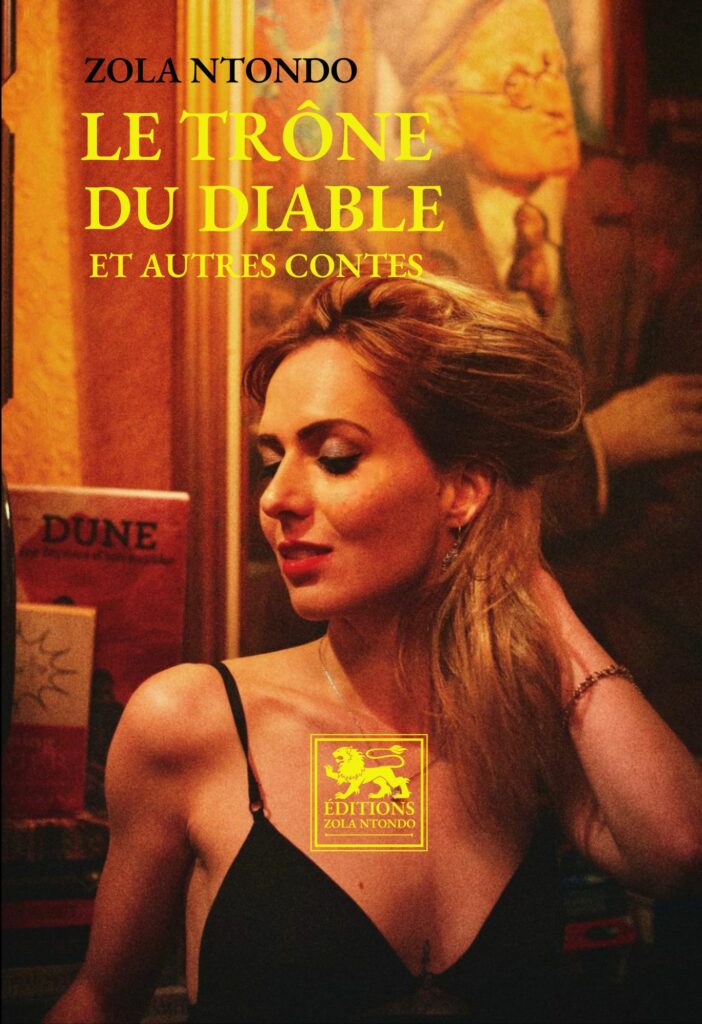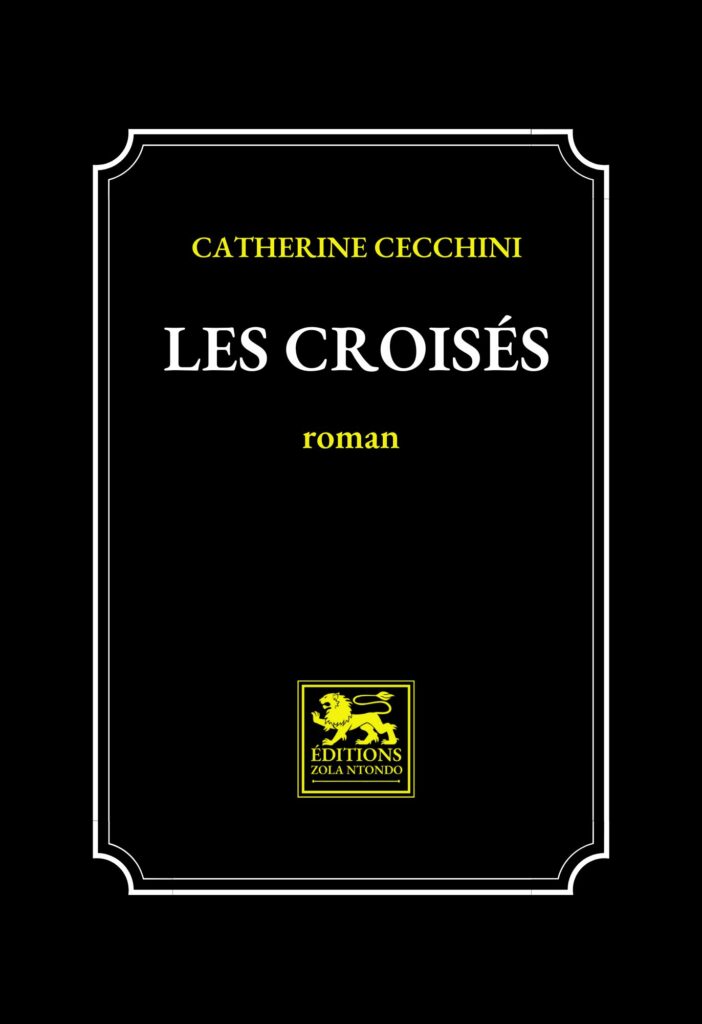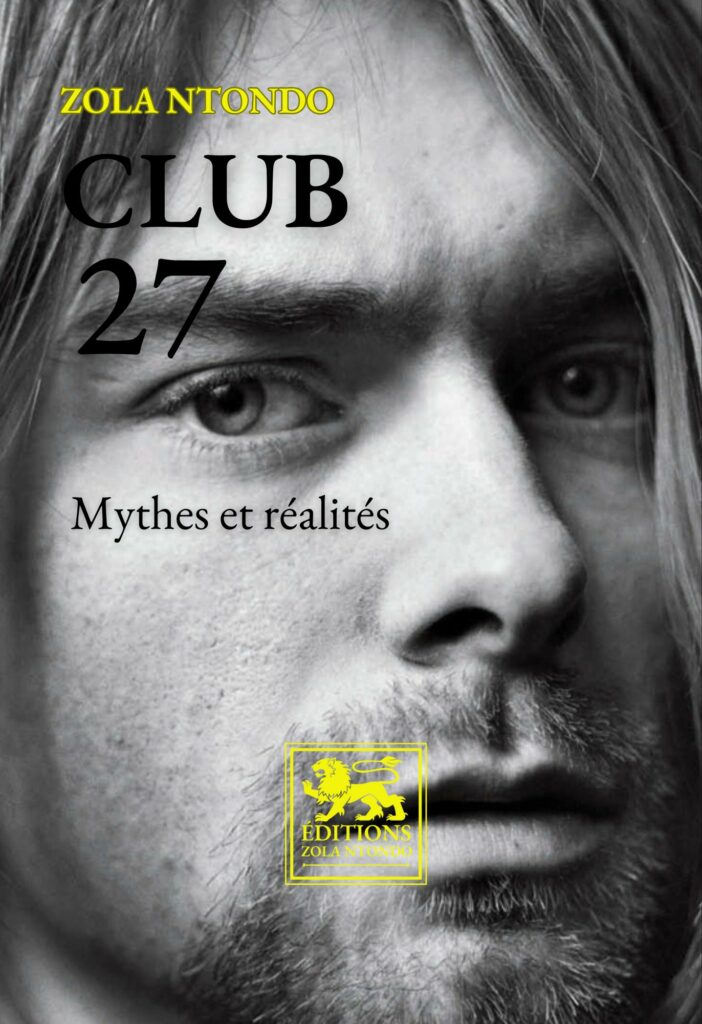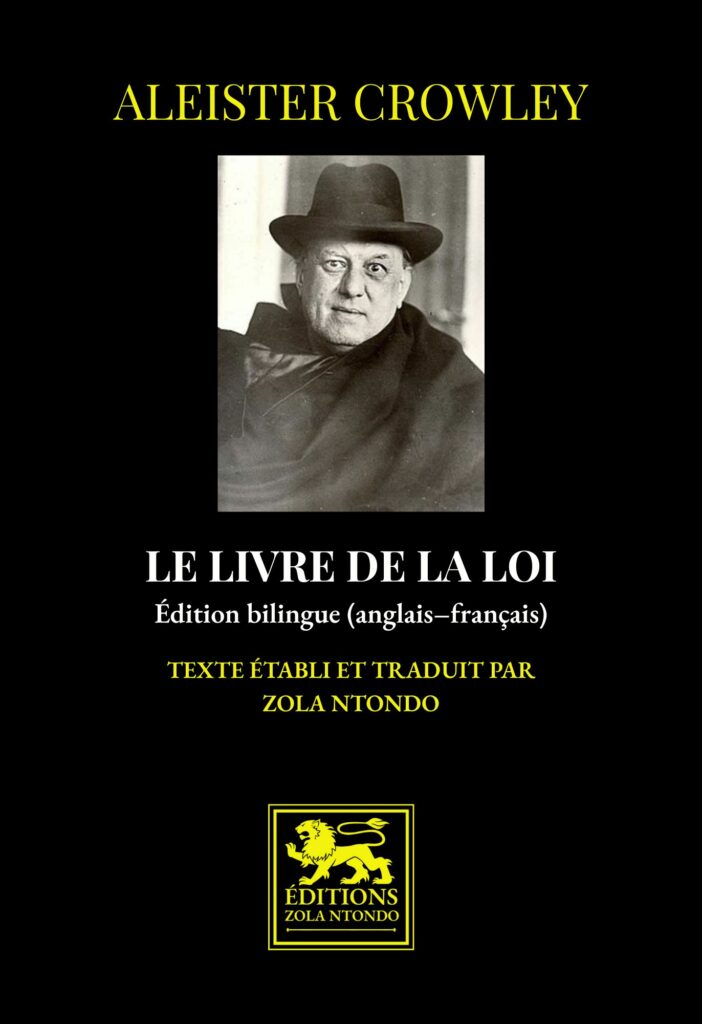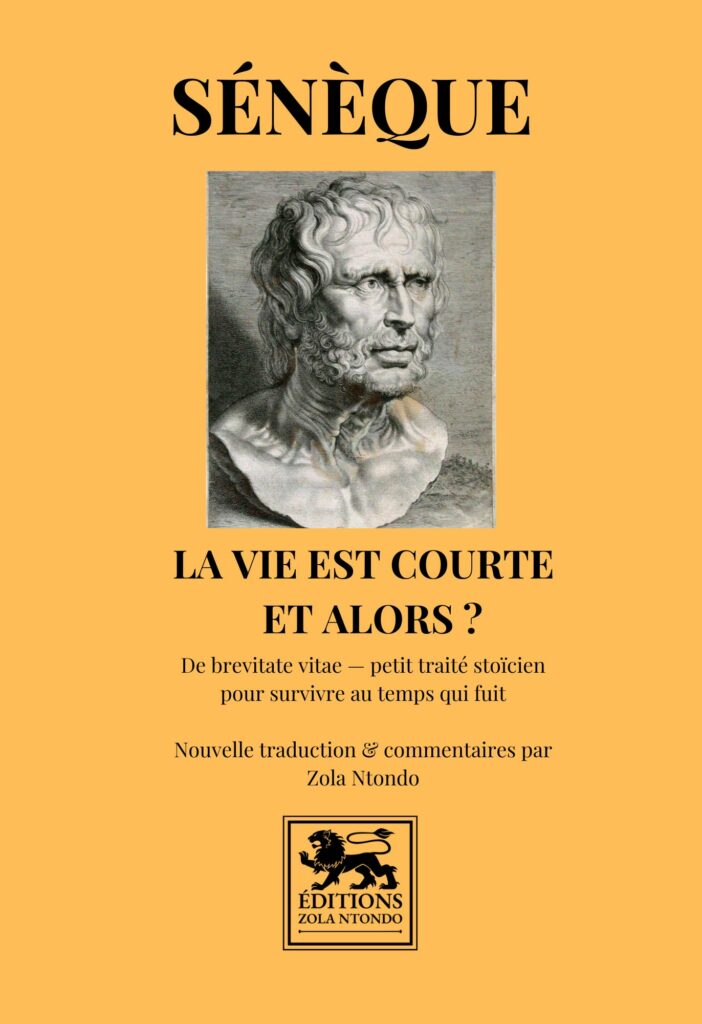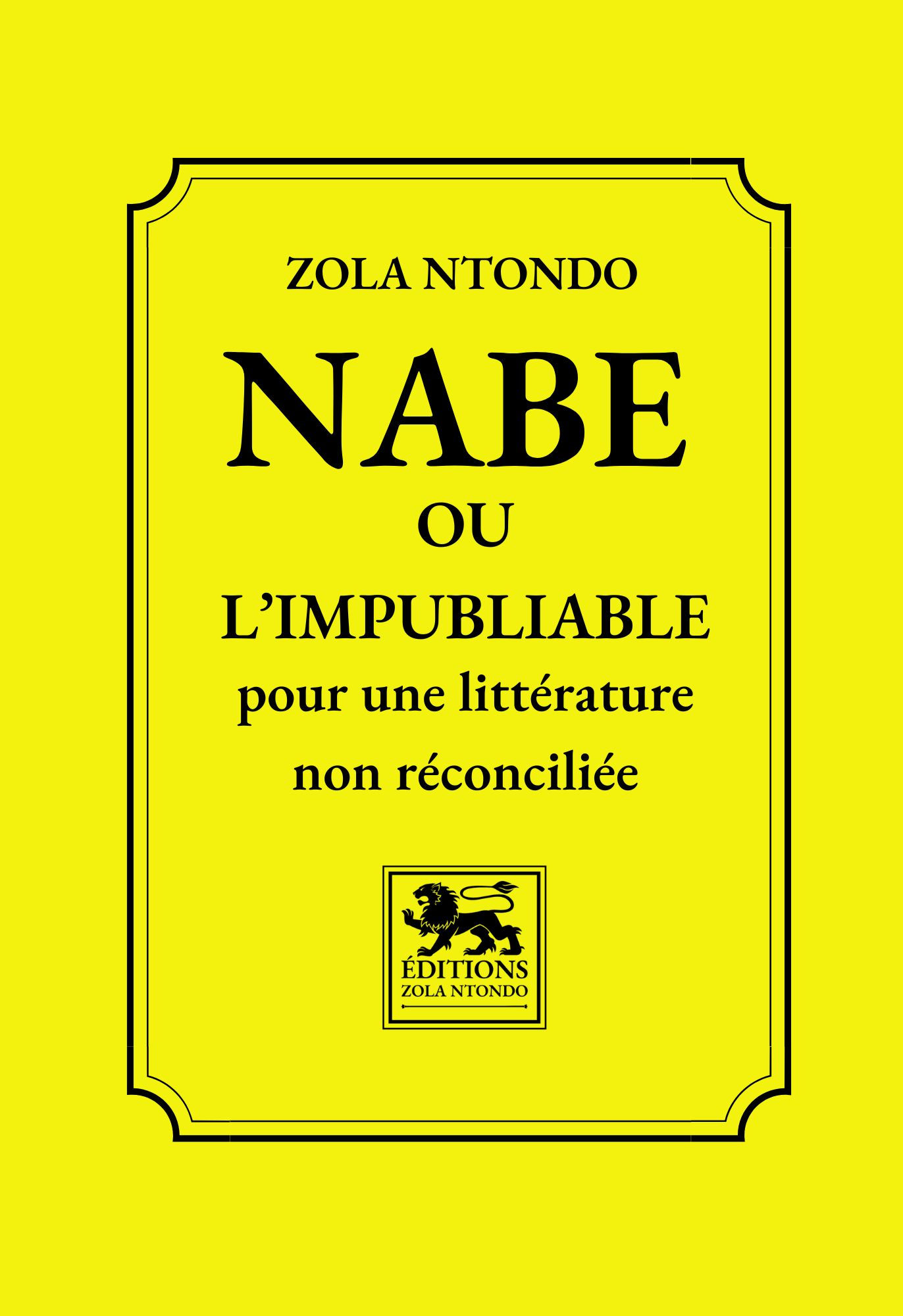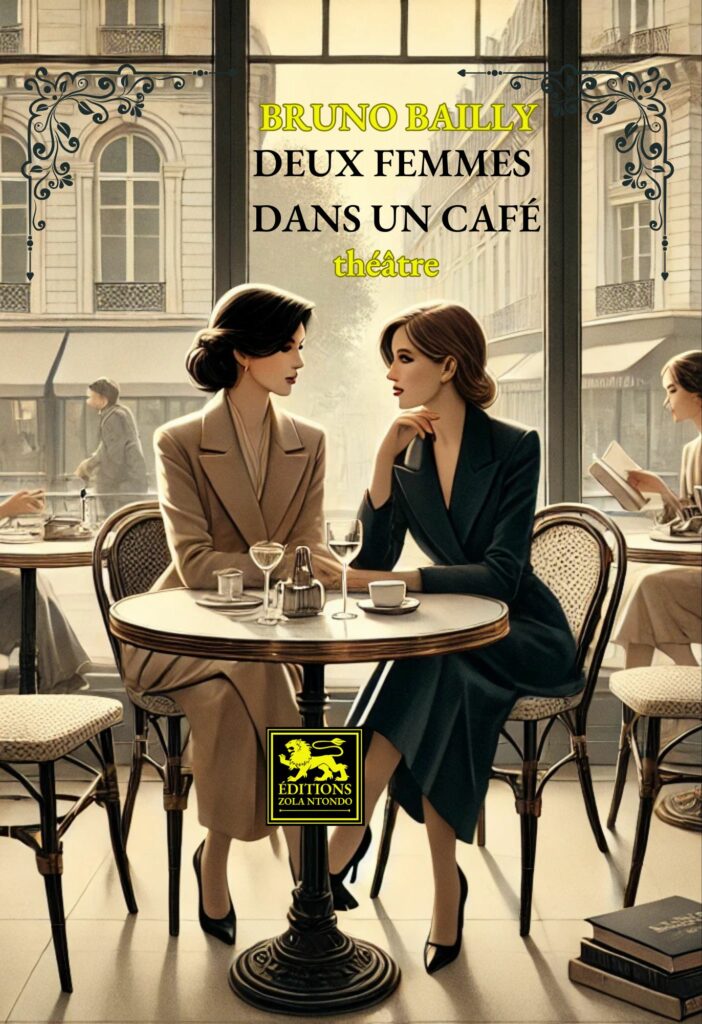La perception à hauteur de museau — Critique de Good Boy (Ben Leonberg, 2025)
Illustration : Affiche officielle. Droits réservés à leurs propriétaires.
Contexte et dispositif
Présenté au SXSW 2025, Good Boy de Ben Leonberg propose une expérience rare dans le cinéma d’horreur : raconter une hantise du point de vue d’un chien.
Le film décentre la vision humaine et déplace la peur de l’événement vers la perception. La maison devient terrain d’épreuve pour un regard animal, antérieur au langage.
Linéarité comme méthode
La linéarité du scénario, souvent perçue comme un défaut, est ici une construction volontaire.
En renonçant à la progression dramatique classique, Leonberg adopte le rythme attentif et répétitif du chien.
Le film se déploie dans une temporalité de guet, d’attente, de micro-variations. Ce choix transforme le spectateur en compagnon du récit :
il apprend à voir plutôt qu’à comprendre. La peur se diffuse par la continuité du regard, non par l’action.
Bruitages et sensorialité
L’espace domestique agit comme un organisme sonore. Les murs respirent, les sols craquent, les silences s’épaississent.
Au fil du récit, les bruitages prennent une dimension ambiguë : ils ne décrivent plus, ils transforment.
Une osmose s’installe entre le spectateur et le protagoniste canin, comme si l’ouïe et l’odorat se trouvaient décuplés.
Halètements, froissements, souffles étouffés acquièrent une densité tactile ; l’horreur s’ancre dans la matière du son.
Une osmose s’installe entre le spectateur et le protagoniste canin, comme si l’ouïe et l’odorat se trouvaient décuplés. Zola Ntondo sur Allociné
Photographie : espace du sensible
La photographie, précise et retenue, privilégie les plans bas, la lumière rasante, les zones d’ombre.
Le cadre demeure fragmentaire, animal. Pas de surenchère visuelle : l’image écoute autant qu’elle montre.
Le hors-champ devient territoire mental, prolongeant la logique perceptive du film.
Présence d’Indy
Indy ne joue pas, il incarne. Chaque orientation du regard, chaque suspension du geste, chaque tension du corps structure la scène.
Captée sans anthropomorphisme, sa présence organise le champ de perception : la peur se manifeste comme phénomène, non comme effet.
Conclusion
En définitive, Good Boy médite la perception plus qu’il ne raconte la peur.
En plaçant la caméra à hauteur de museau, Leonberg décentre la vision humaine et révèle un cinéma de l’écoute, du souffle, du tremblement.
L’horreur y devient une modalité du réel.
La note de Zola Ntondo : 3 sur 5 ★★★☆☆

Zola Ntondo
Éditeur en chef