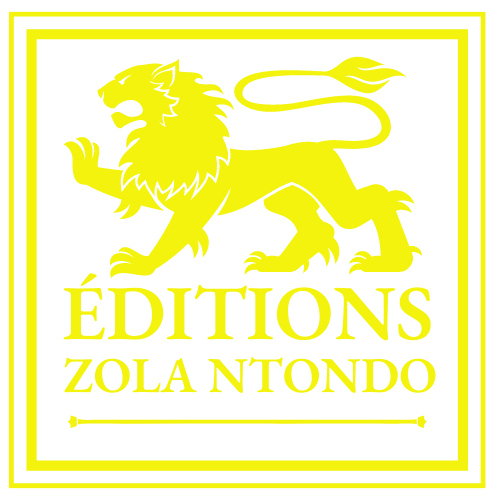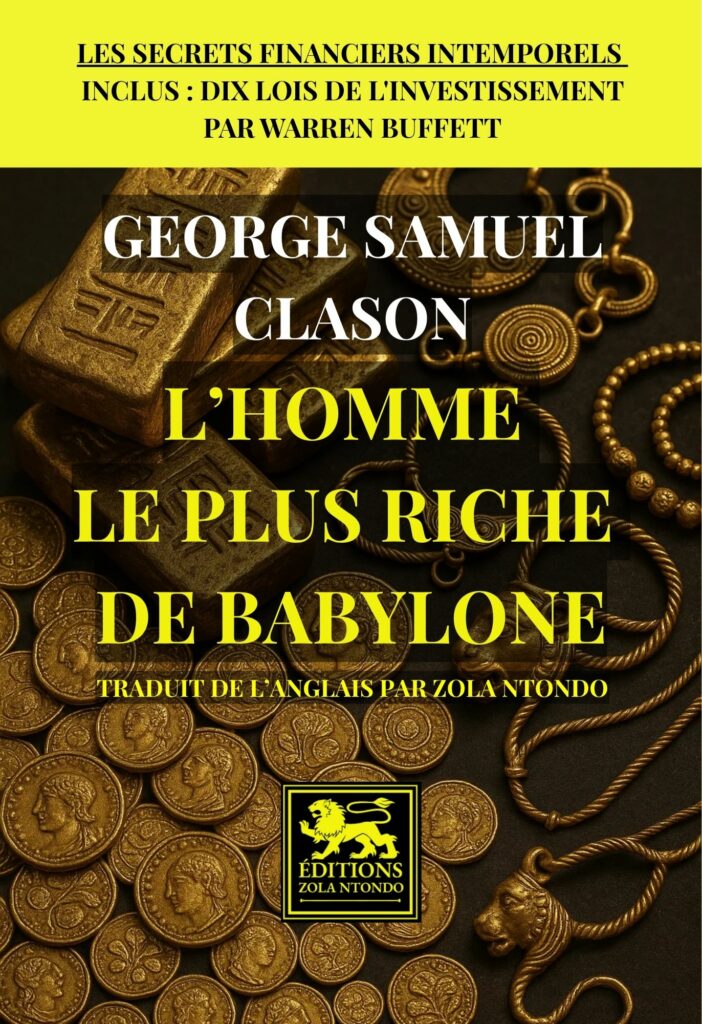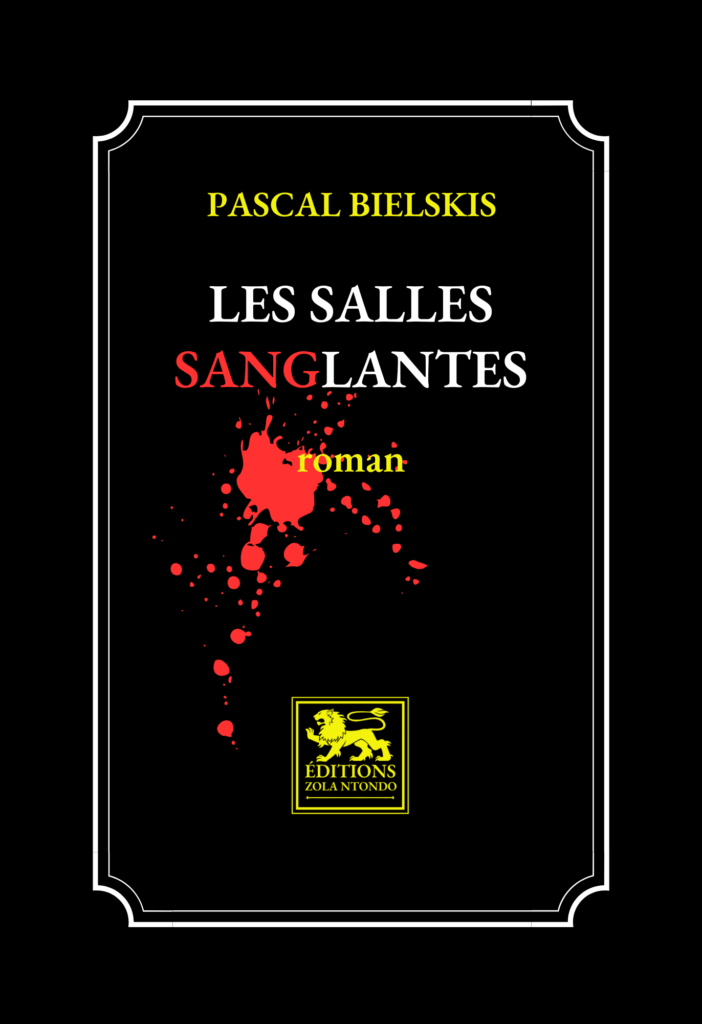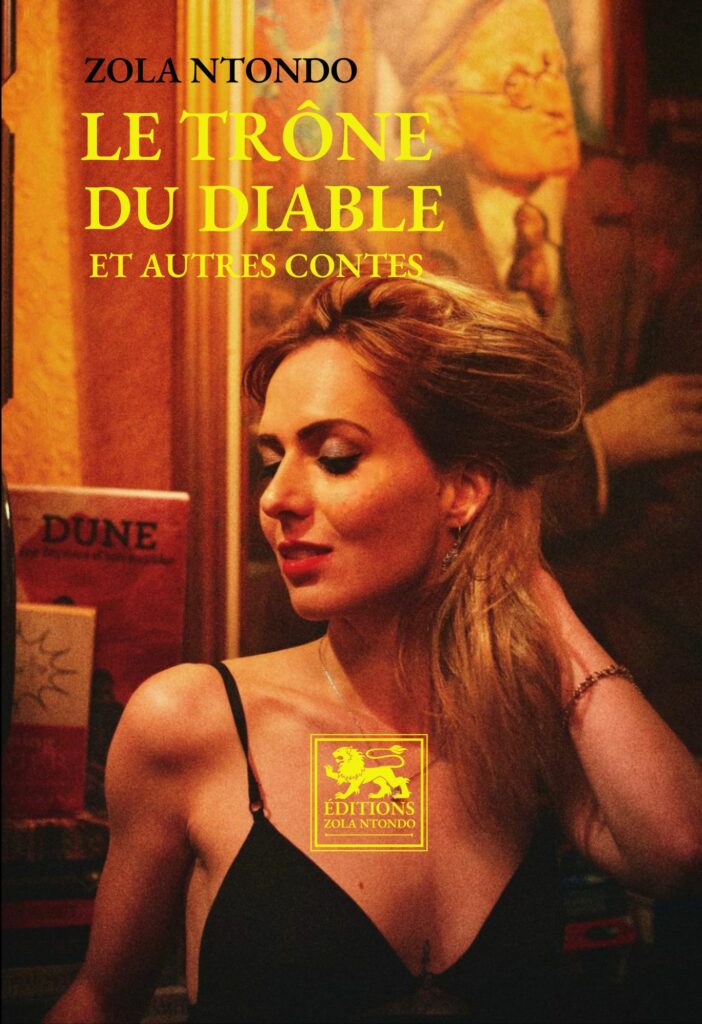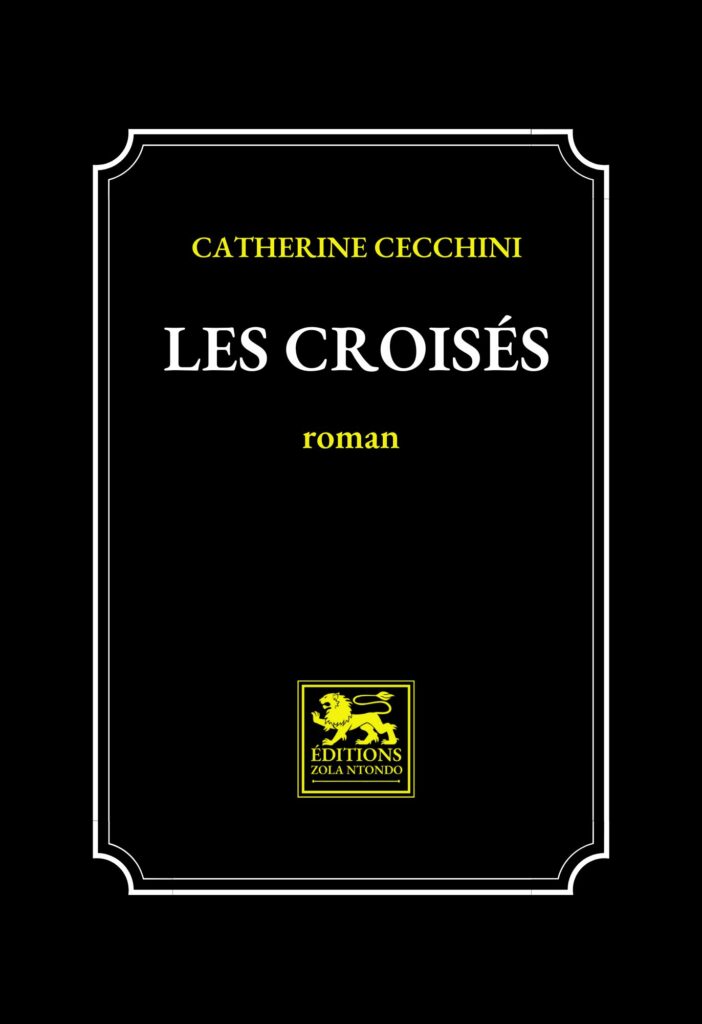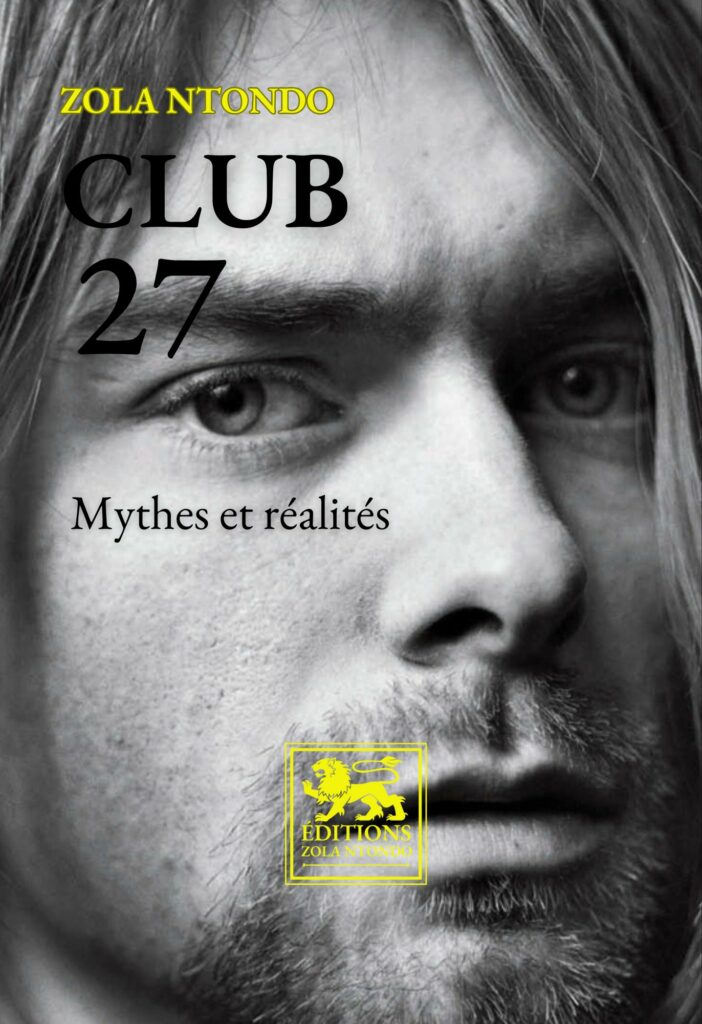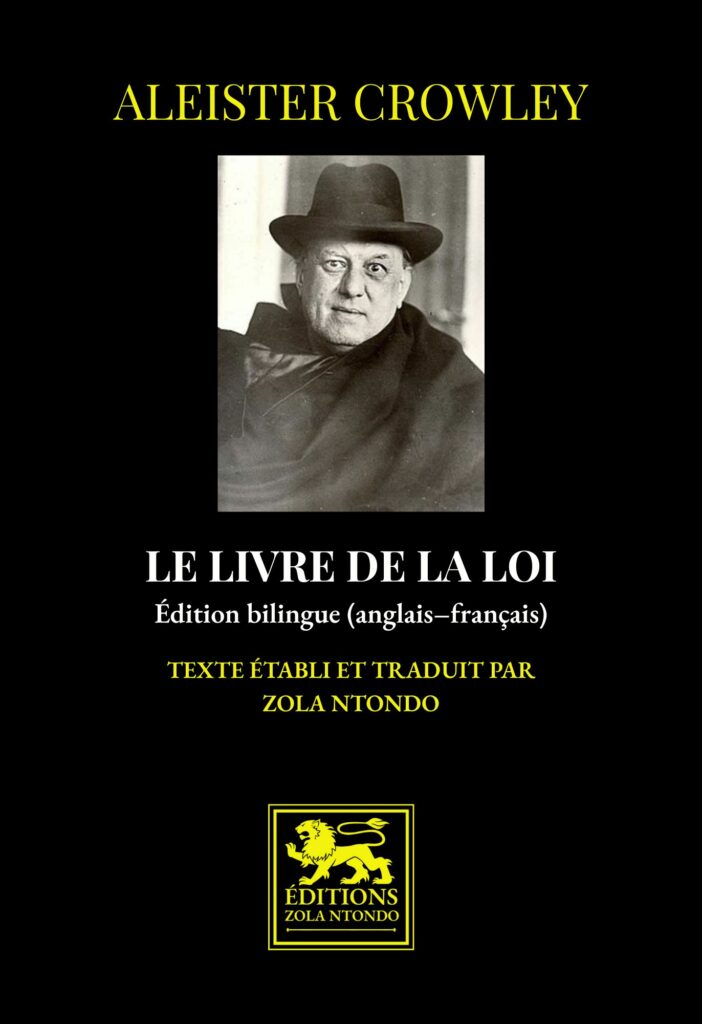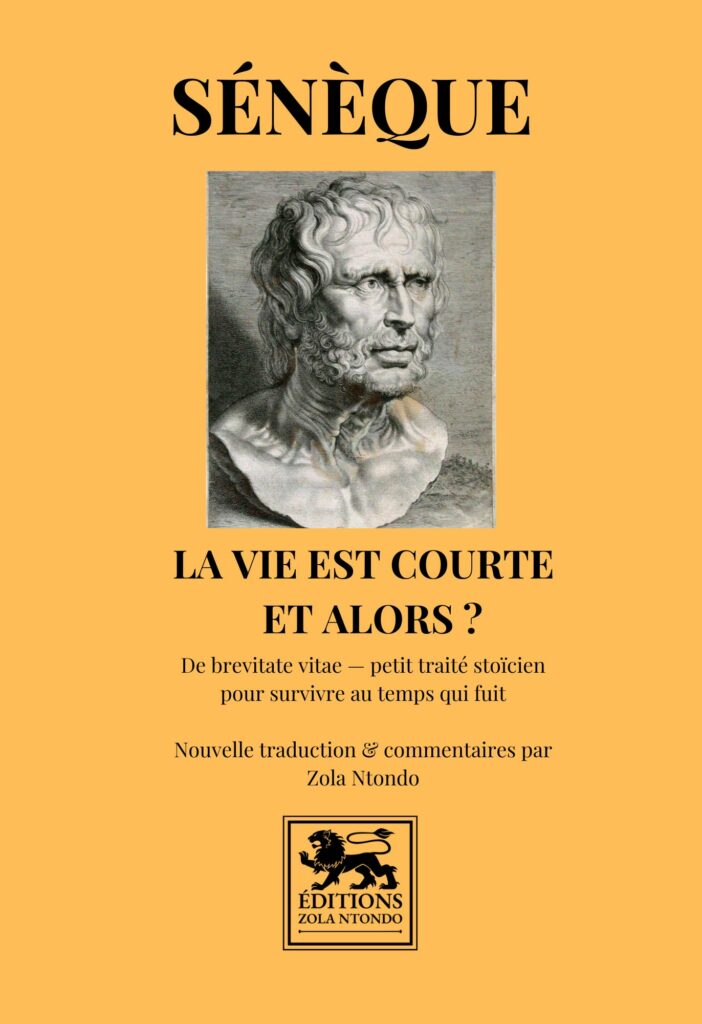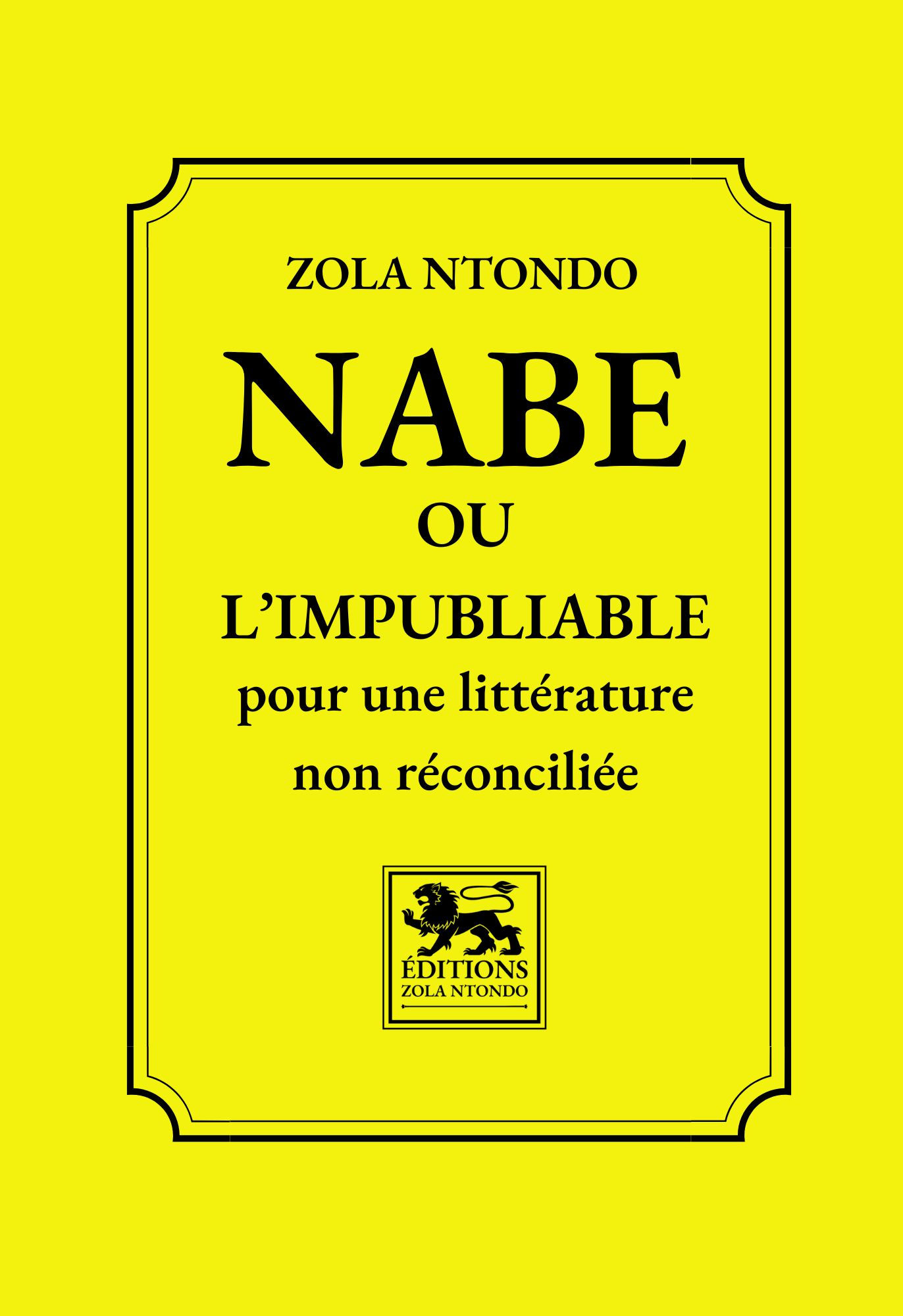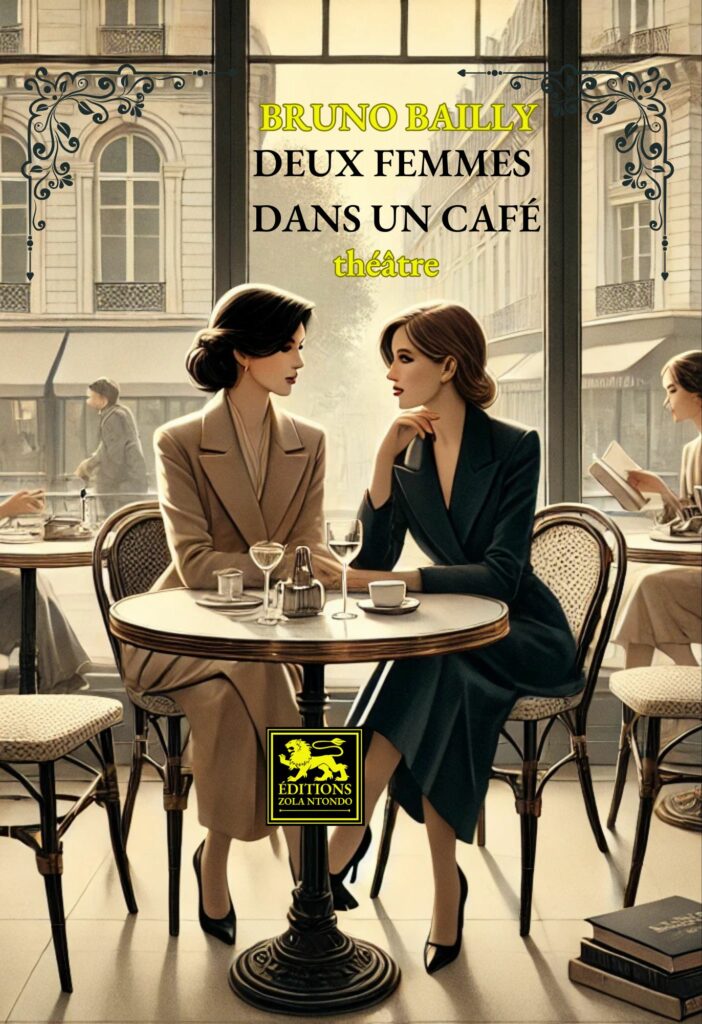La persistance d’un appel — Critique de Black Phone 2 (Blumhouse)
Contexte et ambition de Blumhouse
On reconnaît les œuvres qui ne cherchent pas à revenir, mais à reprendre la place qu’elles n’avaient jamais vraiment quittée. Sous l’égide de Blumhouse, Black Phone 2 ne s’annonce pas par l’esbroufe : il se redépose, préférant l’installation à la surenchère, la durée au sursaut. Le film affirme une volonté de pérennité, comme si une voix longtemps tue reprenait la ligne non pour parler plus fort, mais pour se faire entendre autrement.
L’image comme seuil d’existence
Dans ce film, l’image ne se contente plus de montrer : elle glisse, se rétracte, se densifie, comme si chaque plan cherchait sa propre matière. Tantôt nette, presque clinique, tantôt troublée par un grain ancien, elle varie ses textures pour signaler le passage d’un monde à l’autre — le réel, le souvenir, le rêve. Par instants, l’esthétique rappelle Terrifier, non pour sa cruauté, mais pour son refus du propre : cette matérialité rugueuse qui fait de la pellicule une peau, une surface de friction. Ici, voir ne suffit plus ; il faut sentir. Le cadre cesse d’être fenêtre : il devient seuil.
À lire aussi : Marche ou crève : critique du survival dystopique de Stephen King
Entre veille et cauchemar
L’horreur ne surgit pas par intrusion, elle s’infiltre par imprégnation. Le protagoniste ne lutte pas, il dérive dans une torpeur où l’on cesse de distinguer le sommeil de la veille. L’héritage convoqué n’est pas l’icône mais la mécanique des récits de cauchemar popularisés par la figure de Freddy Krueger : l’effacement des frontières, la contamination du rêve dans le réel. Le mal n’avance pas vers la vie ; il dissout la conscience de l’intérieur. Le cauchemar n’arrive pas — il était déjà là.
Tantôt nette, presque clinique, tantôt troublée par un grain ancien, l’image ne varie pas par coquetterie, mais pour signaler le passage d’un monde à l’autre… Zola Ntondo sur Allociné
Le téléphone : dette et mémoire
L’objet central cesse d’être un simple dispositif. Le téléphone devient instrument de dette : il n’appelle pas pour effrayer, mais pour rappeler ce qui n’a pas été dit, ce qui n’a pas été assumé. Le deuil n’est plus une perte, mais une obligation à honorer. Chaque sonnerie n’annonce pas un danger ; elle réveille une responsabilité. Répondre, ici, n’est pas conjurer la mort, c’est accepter que la mémoire parle encore.
Une lignée d’horreur élégiaque
En refusant la surenchère, Black Phone 2 s’inscrit dans la trajectoire d’œuvres comme It Follows et The Ring, où l’horreur ne triomphe pas par le choc, mais par la persistance. Ce cinéma préfère hanter plutôt qu’effrayer, laisser une trace plutôt qu’un cri. Le film reprend cette lignée et la prolonge : l’image comme mémoire, le temps comme piège, la peur comme élégie.
Conclusion
En définitive, Black Phone 2 transforme l’épouvante en persistance. En jouant des grains d’image comme de plusieurs plans d’existence, en dissolvant la frontière entre veille et cauchemar, en faisant du téléphone le seuil d’une dette, le film ne cherche pas l’instantané : il vise la durée. Lorsque l’écran s’éteint, quelque chose demeure — un appel qui continue de sonner, longtemps après que l’on a raccroché.

Zola Ntondo
Éditeur en chef