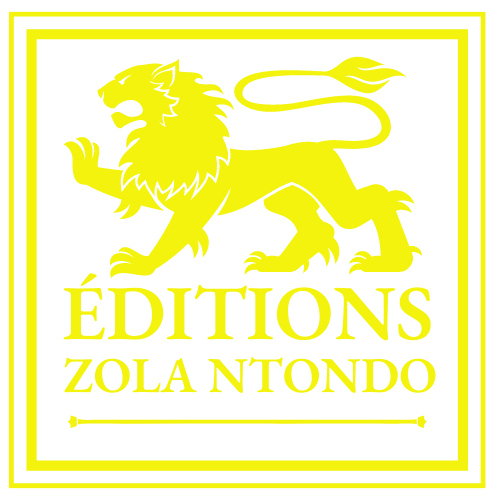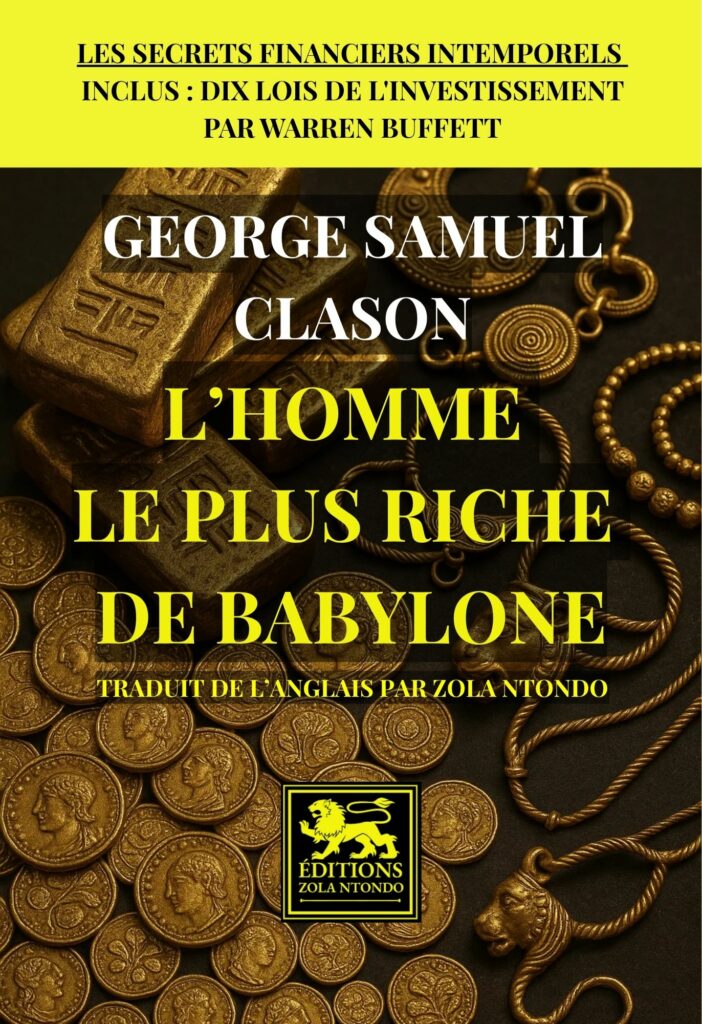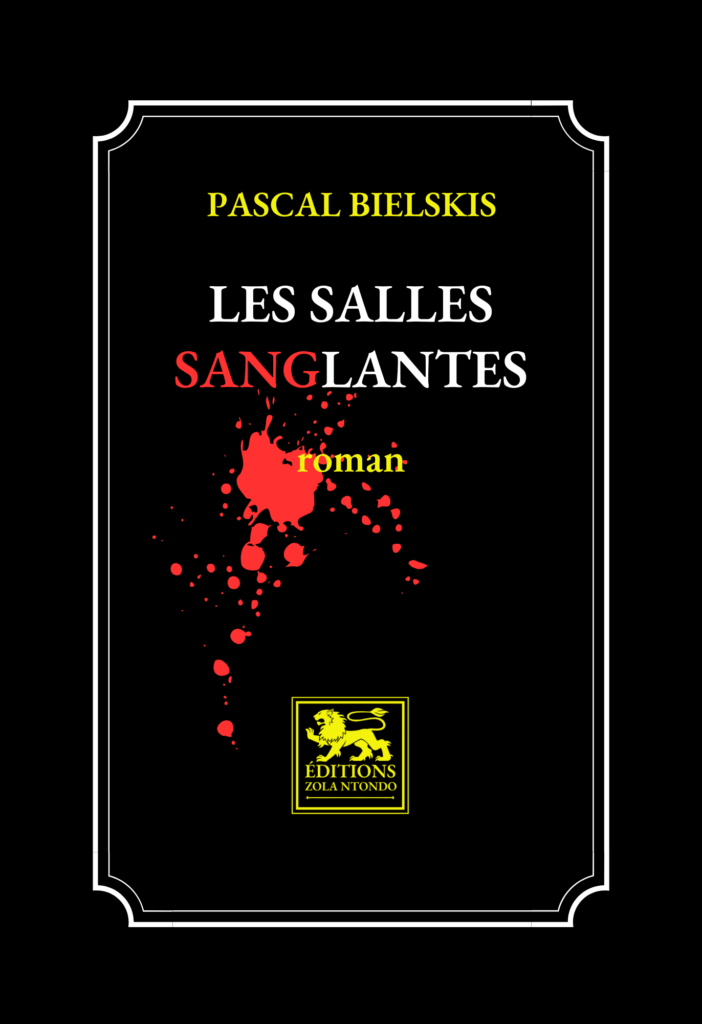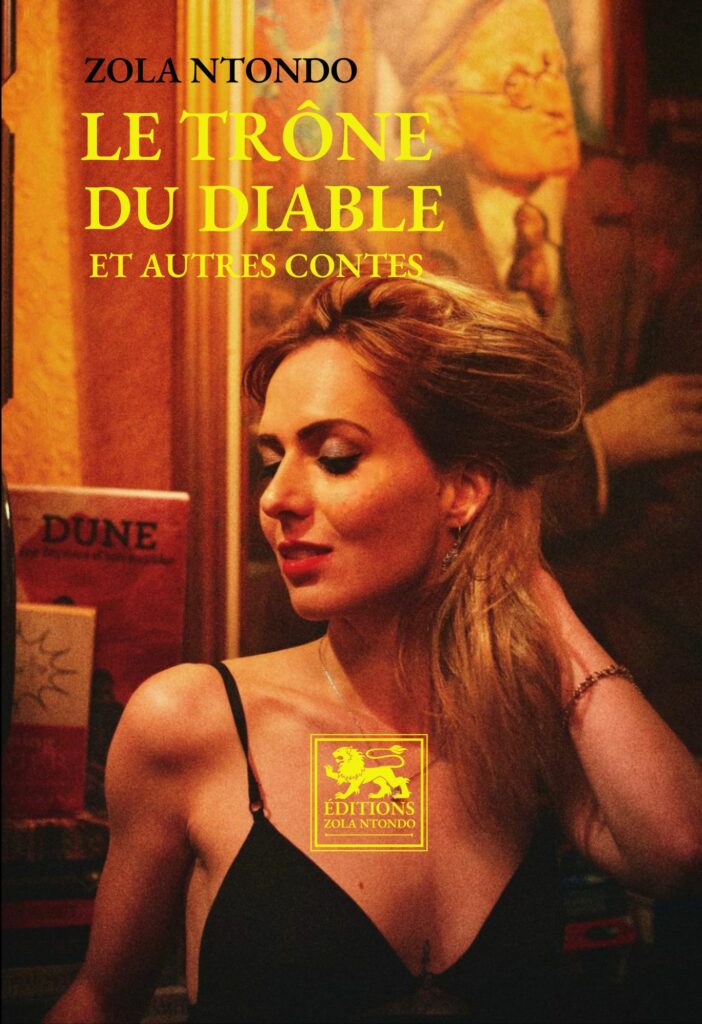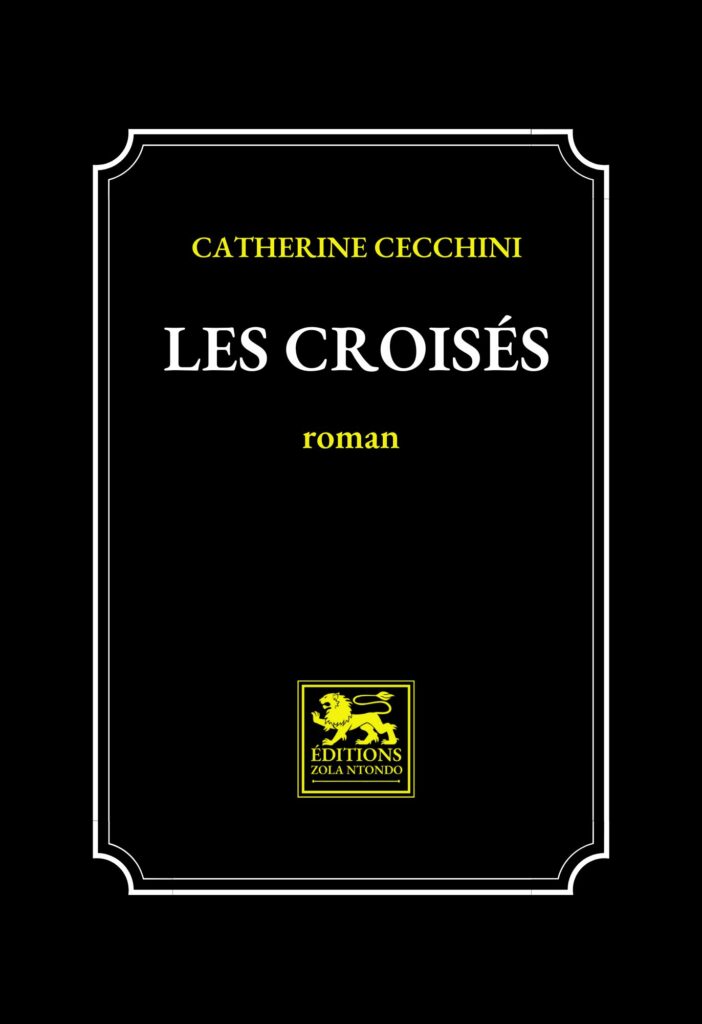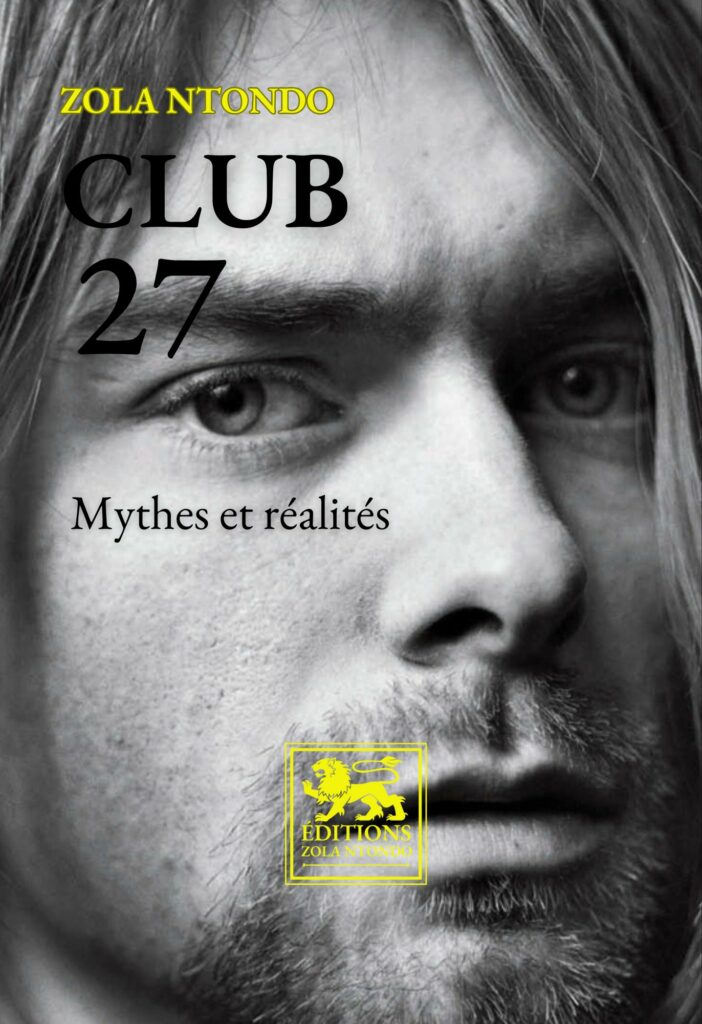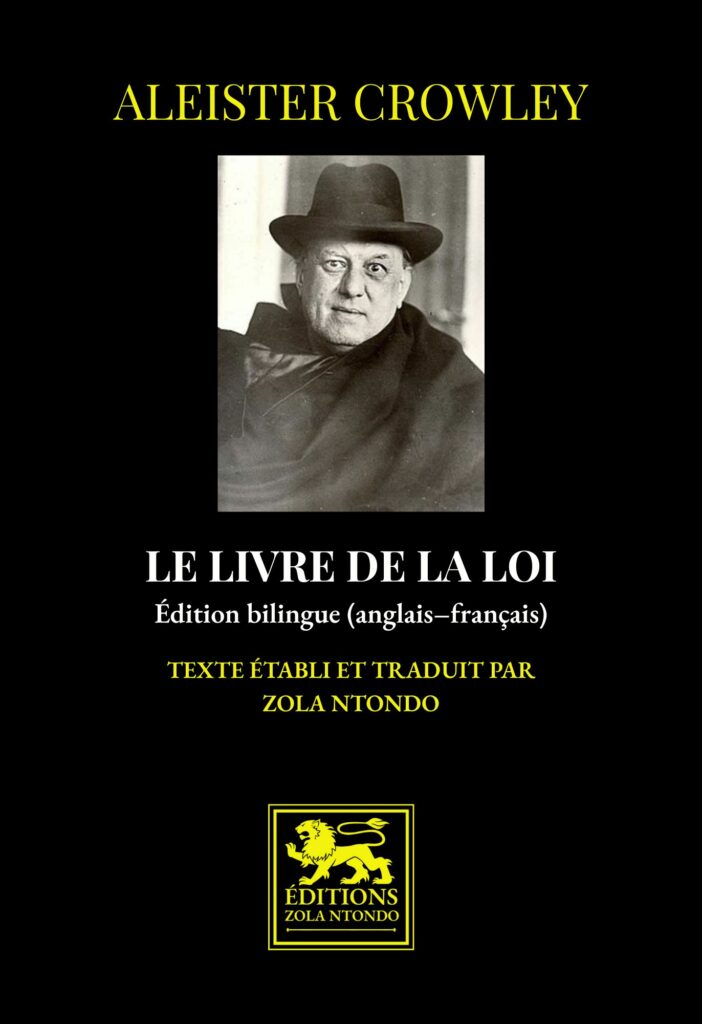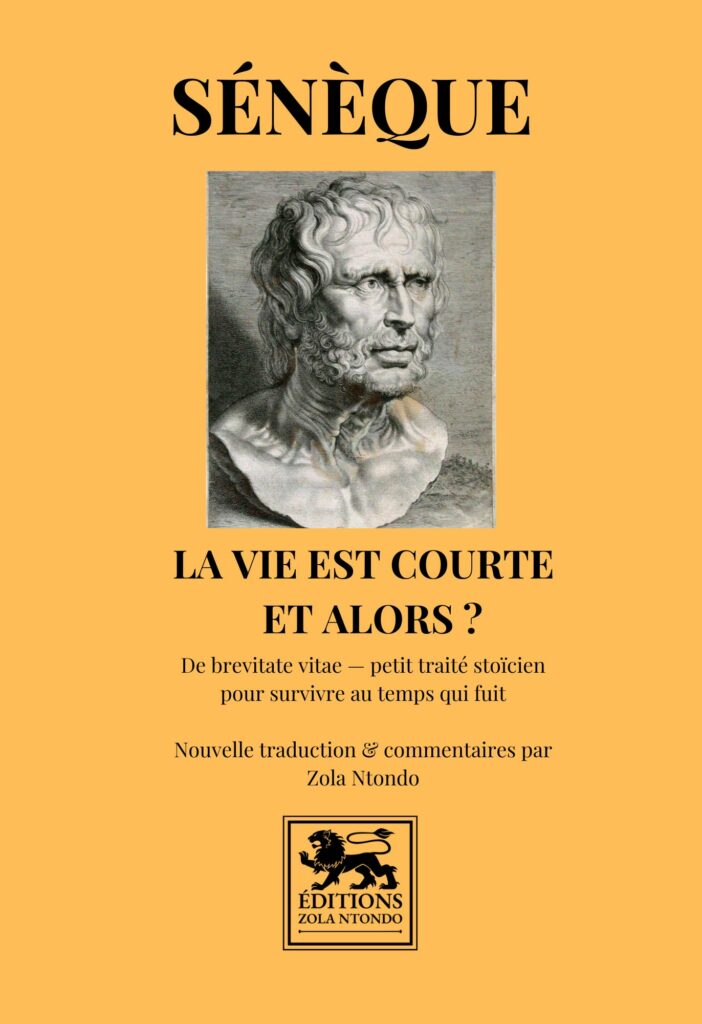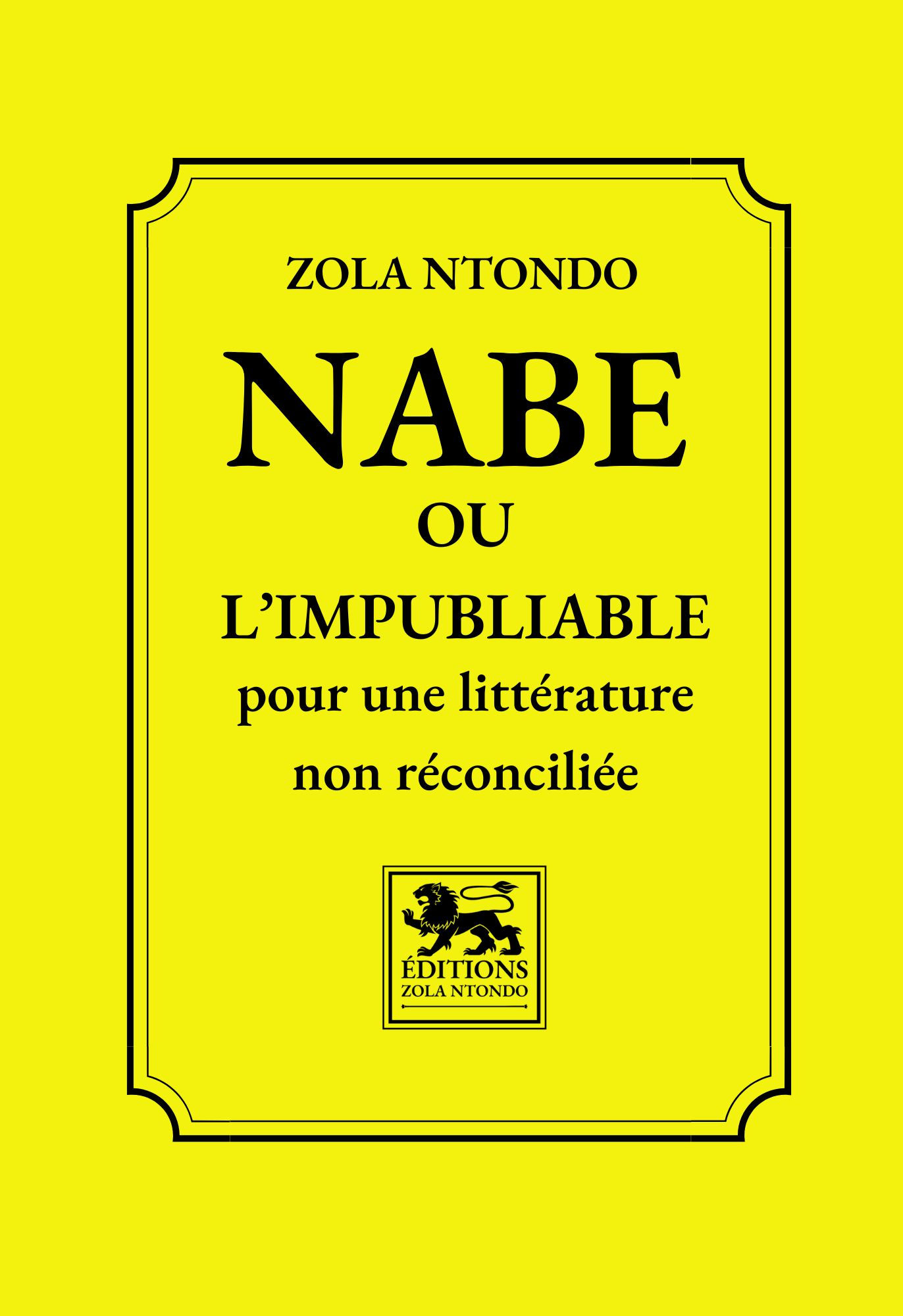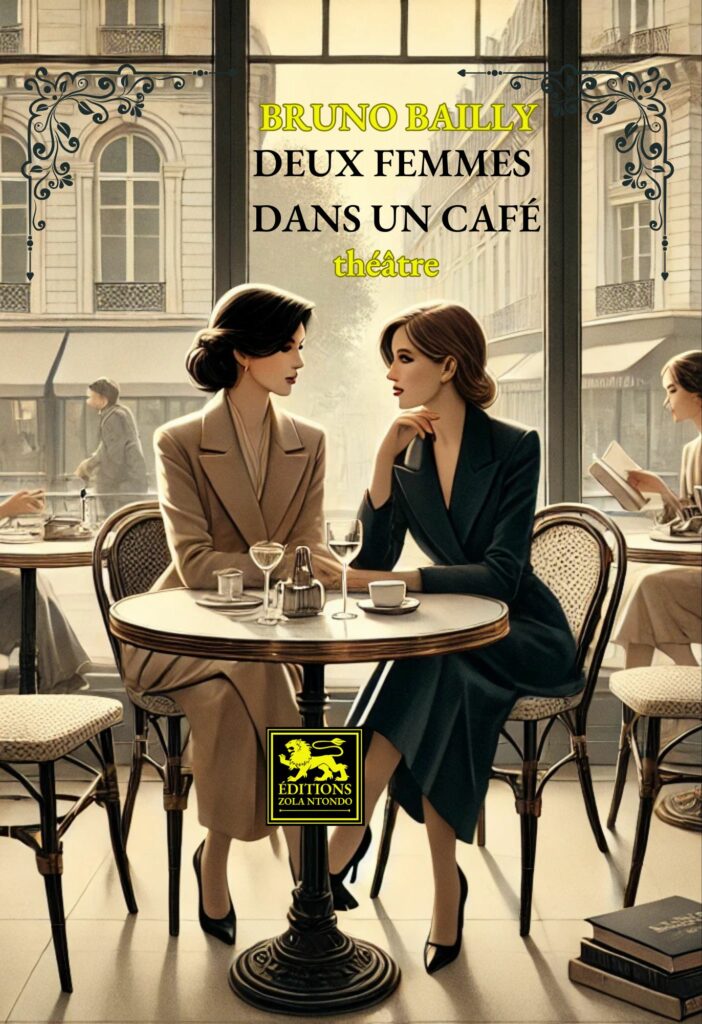Critique du film Nobody 2 : entre violence chorégraphiée et divertissement calibré
Une ouverture spectaculaire
Un poing traverse l’écran. La mâchoire se brise, la caméra s’attarde sur l’éclat de sang suspendu dans l’air. Une voiture dérape, s’embrase, explose dans une pluie d’étincelles. Le vacarme des coups se mêle aux cris étouffés, puis le silence retombe, aussitôt trahi par un ralenti grotesque : un ennemi projeté en l’air, comme suspendu dans une danse macabre. Nobody 2 commence ainsi, dans une débauche de brutalité réglée au millimètre, où chaque geste est chorégraphié, chaque impact orchestré pour séduire l’œil. Le spectateur est saisi, happé par la mécanique du spectacle.
Un récit qui se répète
Mais l’ivresse retombe aussitôt qu’on s’interroge. Car ce que l’on prend d’abord pour une explosion d’inventivité n’est qu’une répétition. Rien de neuf, rien qui ne déborde le cadre déjà tracé par le premier opus. Là où Nobody surprenait en révélant la violence tapie sous l’anodin, sa suite se contente de rejouer la même partition. Le héros ordinaire, Hutch Mansell, reprend son rôle de père sans qualités que les circonstances transforment en justicier implacable. Le décor change — cette fois un parc d’attractions, vitrine d’un réseau criminel — mais l’architecture narrative demeure identique.
Pourtant, il reste Bob Odenkirk. Ce corps non conforme, ni sculptural ni athlétique, conserve une puissance paradoxale. C’est là le charme du film (…) Zola Ntondo sur Allociné
Une mise en scène saturée
La mise en scène elle-même, saturée de mouvements de caméra et de ralentis complaisants, finit par tourner en rond. Héritée du cinéma d’action hongkongais, cette grammaire visuelle se déploie avec une telle intensité qu’elle s’épuise en elle-même. L’action envahit tout, au point d’étouffer le récit. Deleuze parlait de « l’image-action » ; Nobody 2 en est la caricature : un flux de gestes et d’impacts qui ne laisse aucune place au suspens, à la pensée, à cette respiration qui seule donne sens à la violence.
La singularité de Bob Odenkirk
Pourtant, il reste Bob Odenkirk. Ce corps non conforme, ni sculptural ni athlétique, conserve une puissance paradoxale. C’est là le charme du film : voir ce visage marqué, ce corps vulnérable, se muer soudain en machine implacable. La surprise s’est émoussée, mais l’effet fonctionne encore. Le spectateur rit, s’étonne, se laisse emporter malgré la prévisibilité du récit.
Un divertissement sans invention
C’est tout le paradoxe de Nobody 2. Le film n’apporte rien de nouveau, il n’ouvre aucune brèche dans le genre, il reconduit à l’identique ses procédés. Et pourtant, il divertit. L’expérience est sans profondeur, mais non sans plaisir. On sort de la salle conscient d’avoir vu une redite, et malgré cela, on ne regrette pas d’avoir cédé à la mécanique du spectacle. Le cinéma industriel ne se hisse pas ici au rang d’art inventif, mais il accomplit avec rigueur sa mission la plus élémentaire : captiver, amuser, distraire.
La note de votre humble serviteur : 3 sur 5 ★★★☆☆

Zola Ntondo
Éditeur en chef