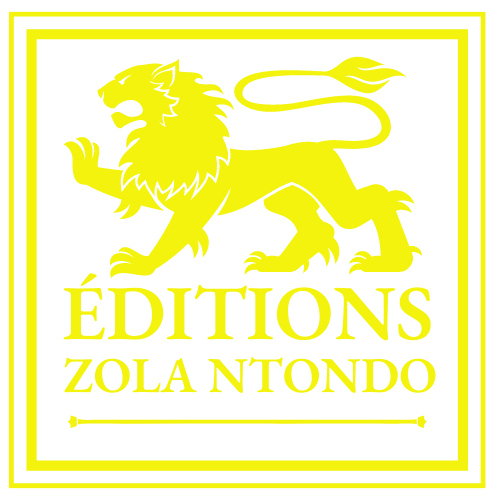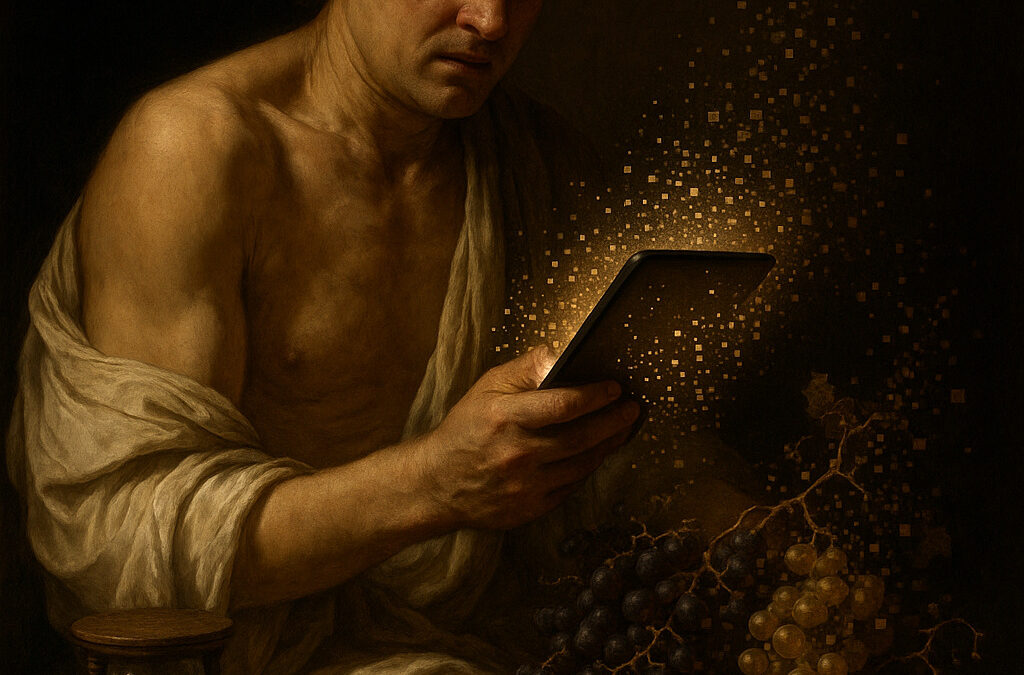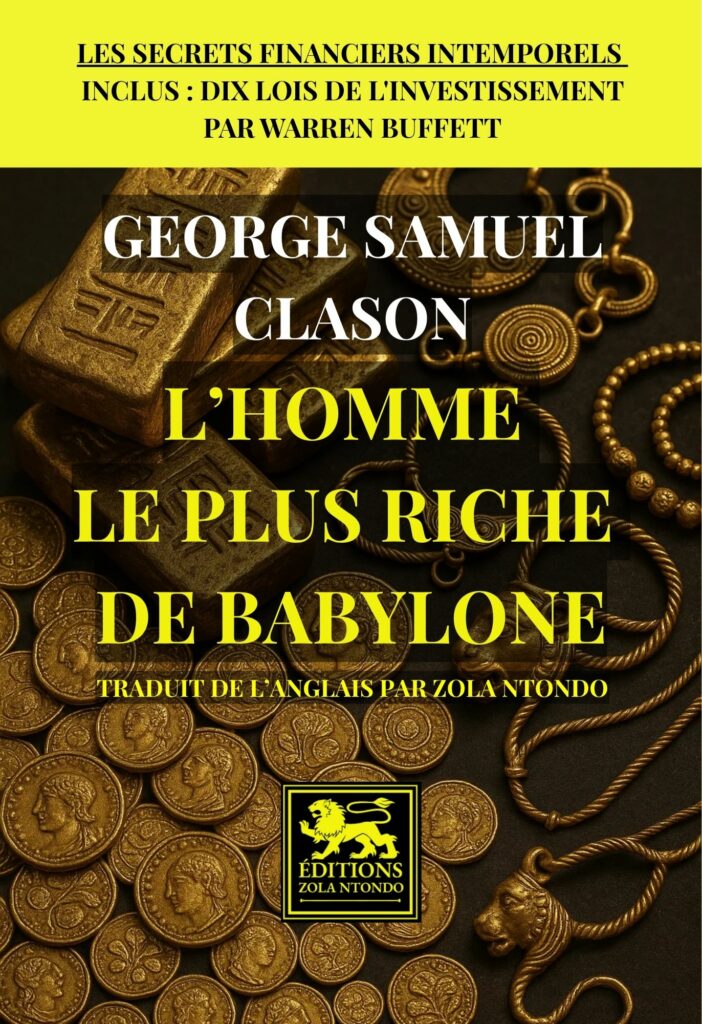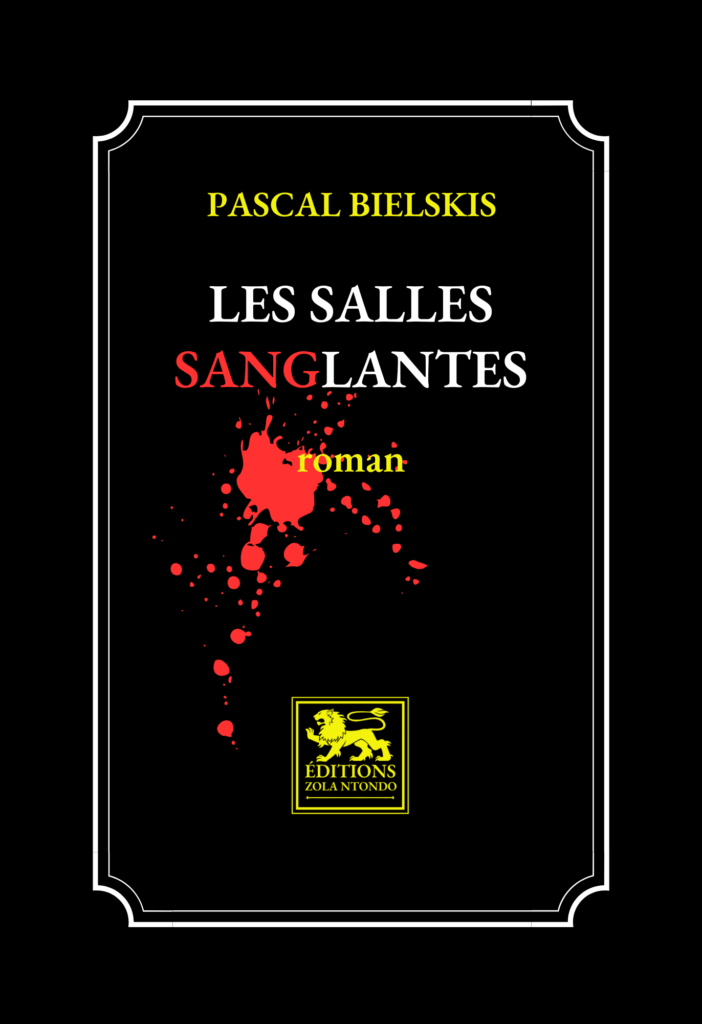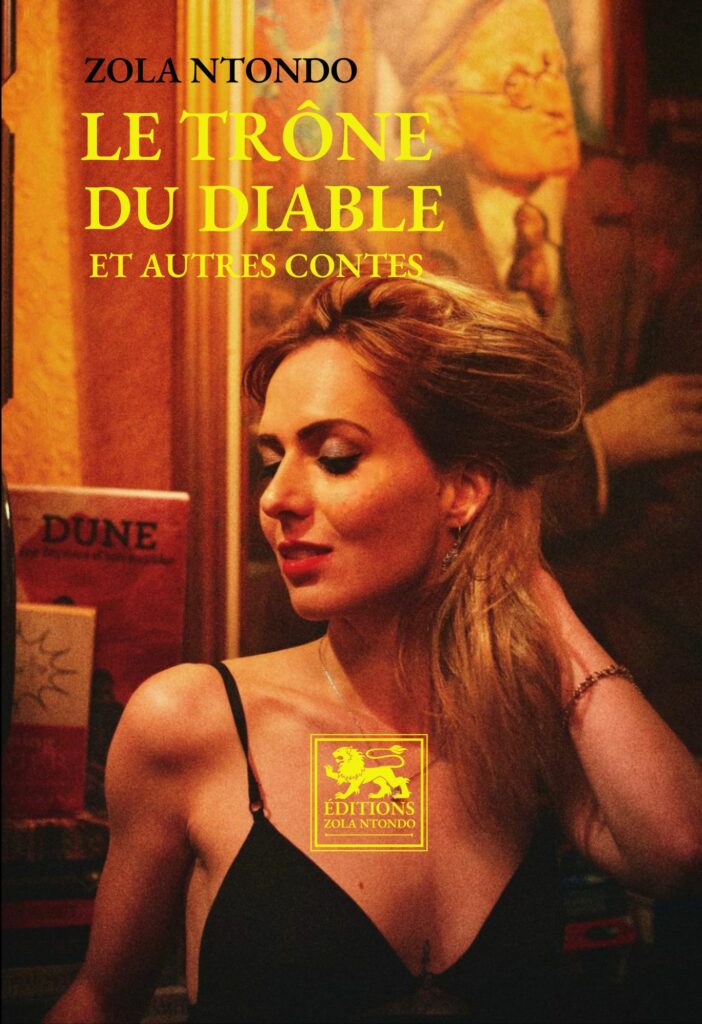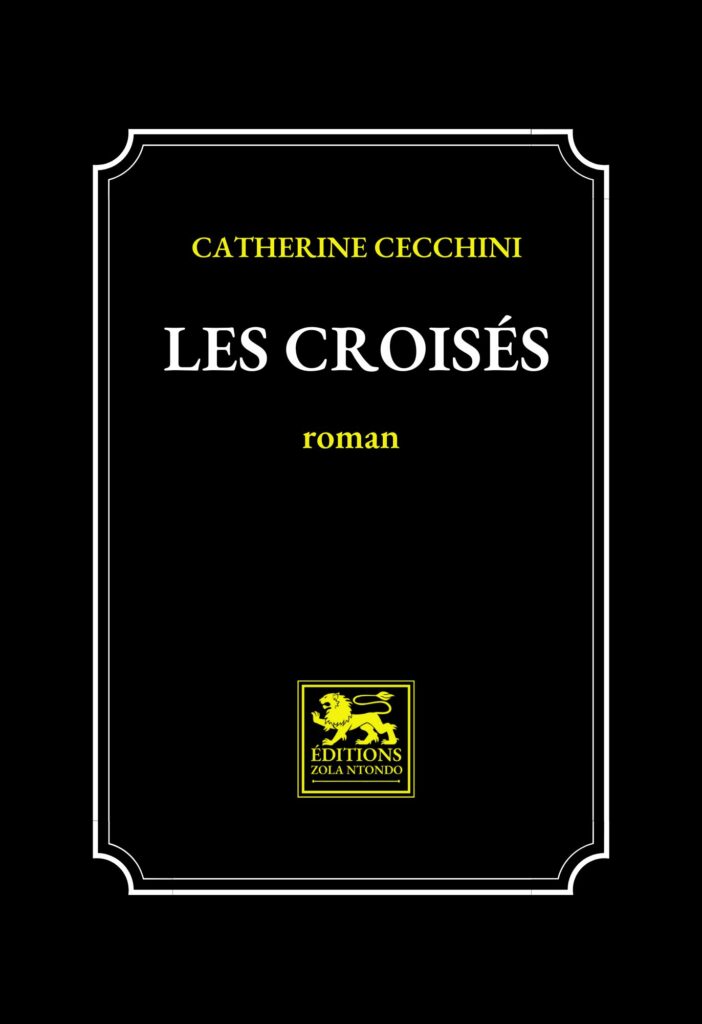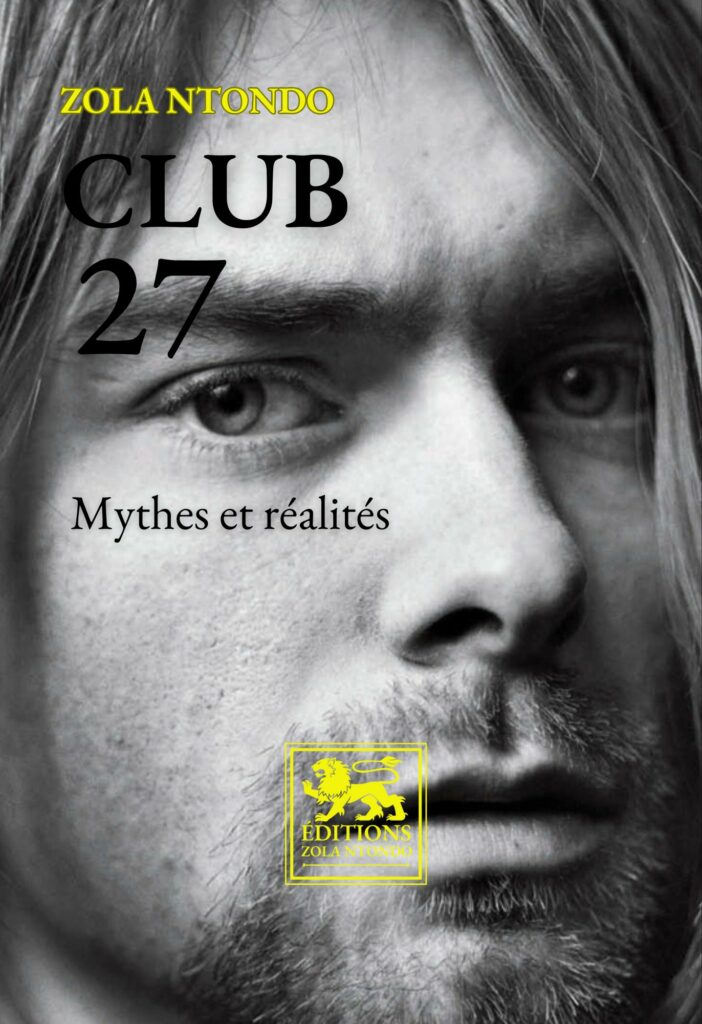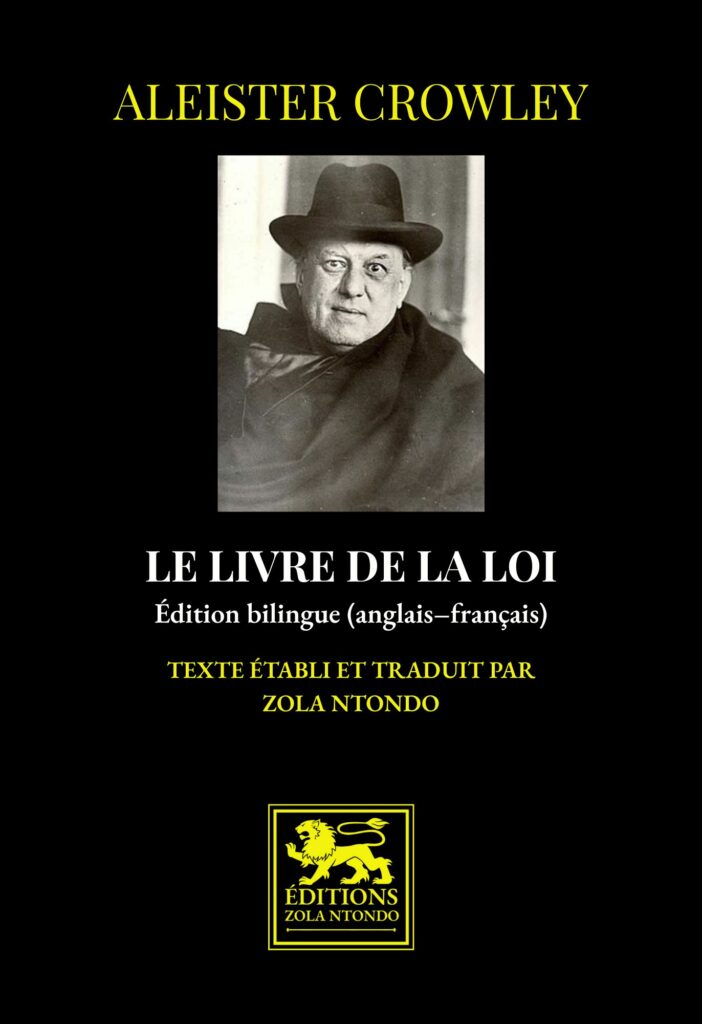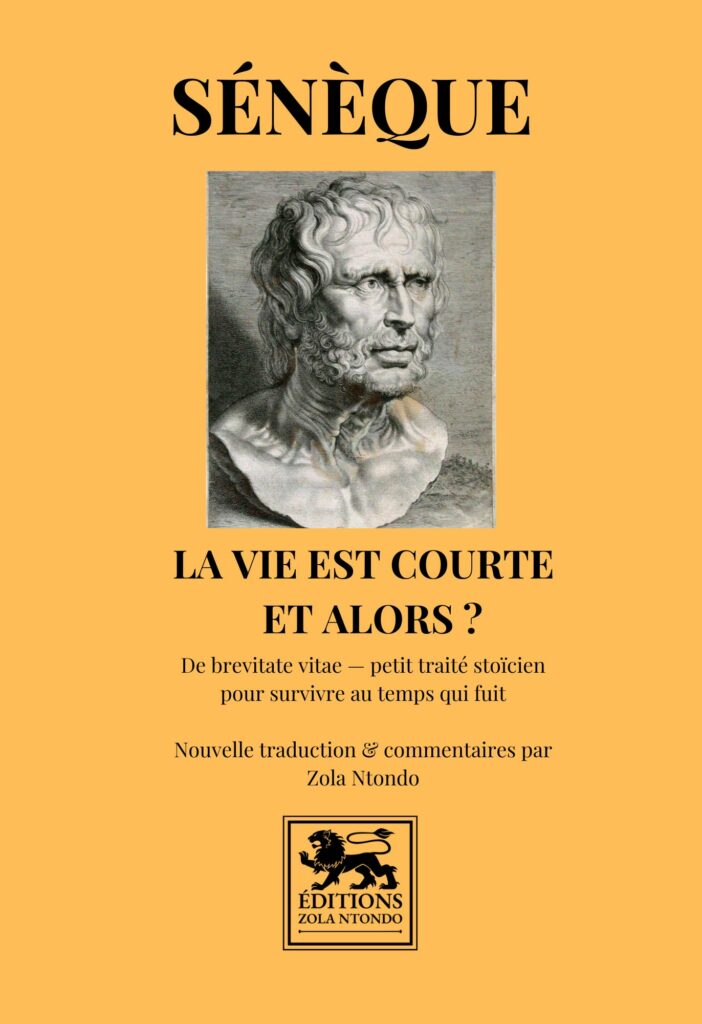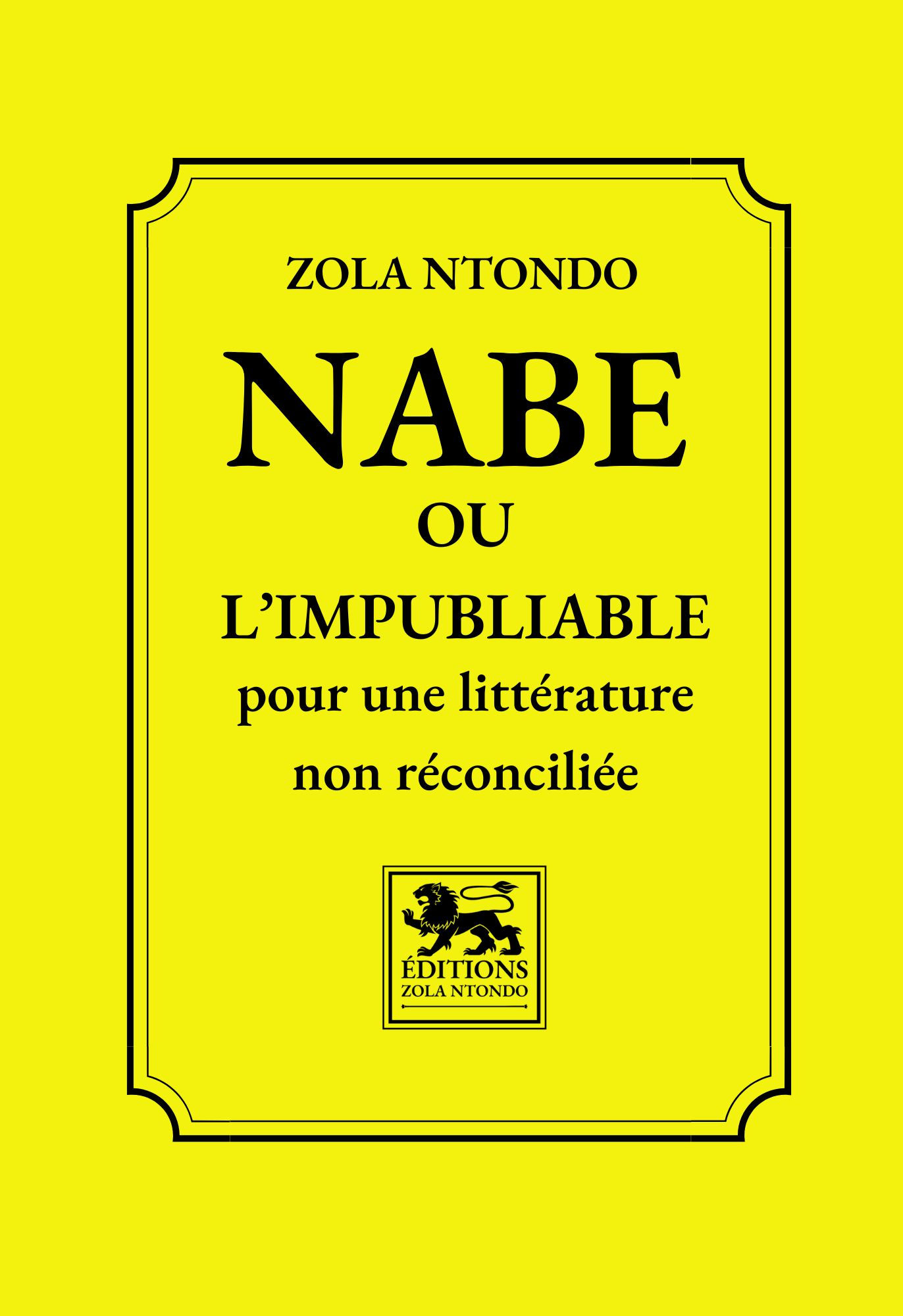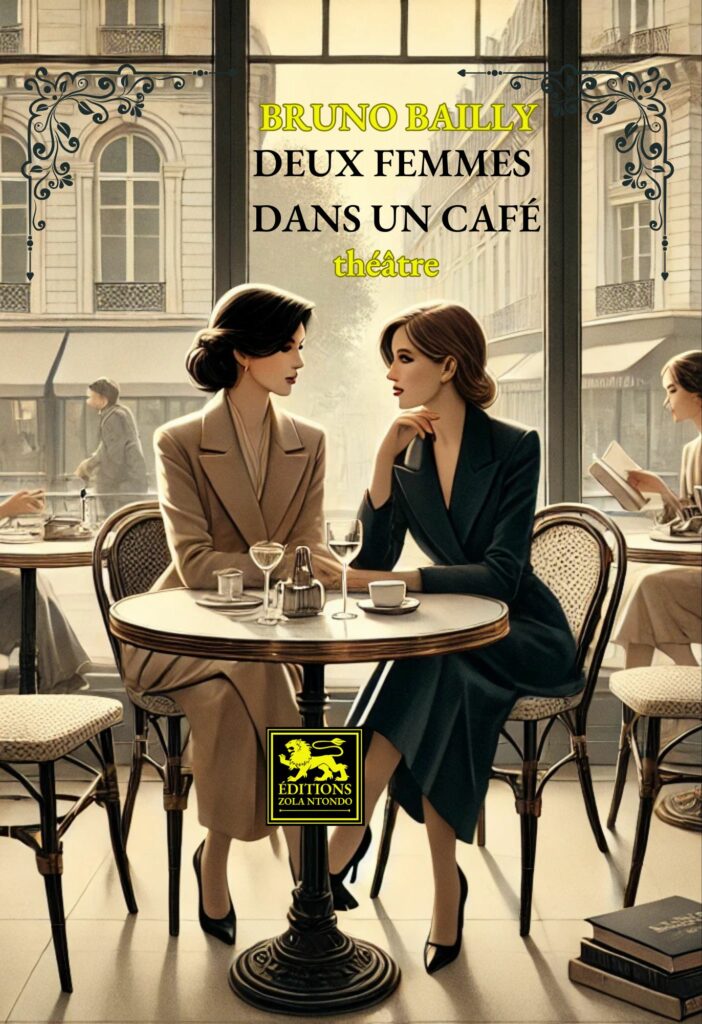L’édition française : un système en voie d’archaïsation
Héritière d’un modèle forgé au XIXᵉ siècle, l’édition française se trouve aujourd’hui confrontée à un monde qui ne lui ressemble plus. Crise sanitaire, plateformes, nouveaux juges invisibles : les signes d’un décalage s’accumulent. Mais que devient un système qui choisit de survivre plutôt que de se transformer ?
Sommaire
Un décalage de plus en plus visible
La crise sanitaire comme révélateur
Amazon, alors figure de proue des GAFAM
L’innovation qui déplace les frontières
Un décalage de plus en plus visible
Il est devenu difficile de nier le décalage grandissant entre les maisons d’édition traditionnelles et le monde dans lequel elles prétendent encore régner. Ce décalage ne tient pas seulement à la lenteur de leurs structures, ni au poids de leurs héritages, mais à une manière d’être au monde qui privilégie la conservation à l’invention, la reproduction à la création. Ce qui devrait être un foyer de vitalité littéraire se transforme peu à peu en un système d’archaïsation, où l’on célèbre la stabilité alors que la culture se nourrit du mouvement.
La crise sanitaire comme révélateur
Cette inertie, que l’on croyait parfois encore soutenable, s’est révélée au grand jour lors de la crise sanitaire. Le temps des confinements a accéléré ce que l’on feignait de ne pas voir : la centralité des achats en ligne, l’hégémonie des plateformes, l’impuissance des réseaux traditionnels lorsqu’ils se retrouvent privés de leur socle physique. Le Covid n’a pas inventé la mutation, il en a simplement précipité la cadence, montrant à quel point les habitudes d’accès au livre avaient déjà basculé vers un autre monde.
Amazon, alors figure de proue des GAFAM
C’est dans ce contexte que l’on a vu Amazon, alors figure de proue des GAFAM, devenir la cible privilégiée des critiques. On l’érige volontiers en diable. Les reproches, il est vrai, ne manquent pas : domination écrasante, pratiques discutables, logique marchande qui semble ignorer la fragilité du tissu culturel. Mais ce qui rend ce procès singulier, c’est qu’il est intenté par des institutions dont l’histoire, elle, témoigne d’accommodements autrement plus lourds. Pour préserver leur statut, les plus grandes maisons surent se plier aux exigences du régime de Vichy, composer avec l’occupant, ajuster leur conduite aux circonstances. Le contraste est frappant : hier, l’honneur se pliait à la nécessité ; aujourd’hui, c’est au nom de la morale que l’on condamne.
L’innovation qui déplace les frontières
Il convient de souligner ici une différence de nature. L’occupation n’a laissé dans la société française que blessures et divisions, sans aucun apport que l’on puisse revendiquer. Amazon, malgré les critiques légitimes qu’il suscite, a introduit des innovations qui ont profondément reconfiguré le champ littéraire. L’impression à la demande, en particulier, a ouvert le jeu au-delà du cercle restreint des élites parisiennes. Elle a permis à des auteurs jusque-là invisibles de publier, à des lecteurs d’accéder à des voix hors des sentiers balisés par les académies et les jurys. Là où les structures traditionnelles fermaient les portes, la technique a déplacé les frontières.
Hier, l’honneur se pliait à la nécessité ; aujourd’hui, c’est au nom de la morale que l’on condamne…
Le précédent Netflix
Ce schéma n’est pas inédit. Lorsque Netflix entra en France, Canal+ mobilisa tous ses leviers pour freiner son implantation, invoquant l’exception culturelle, avant de céder et de lancer, tardivement, MyCanal. Refus d’abord, diabolisation ensuite, imitation enfin : telle est la mécanique récurrente d’institutions trop attachées à leur rôle pour concevoir qu’il puisse être redéfini.
Un changement d’autorité
En réalité, le véritable problème n’est pas la figure que l’on désigne comme adversaire, mais le déplacement de l’autorité. Hier, la crédibilité d’un livre se décidait à l’ombre des académies, des prix, de la critique savante. Aujourd’hui, elle se joue dans le flux mouvant des moteurs de recherche, des recommandations automatisées, des tendances virales. L’autorité symbolique subsiste, mais l’autorité effective — économique et culturelle — s’est déjà déplacée.
Le confort de l’archaïsation
Or, les maisons françaises n’ont pas le besoin vital de se transformer. Leur modèle reste rentable, leur rente patrimoniale intacte, leur prestige reconnu. Mais cette sécurité est précisément leur archaïsation. Les équipes, formées dans des écoles où l’on enseigne un savoir canonisé, apprennent à préserver davantage qu’à inventer. De là naît une vision solidifiée, incapable d’accompagner la fluidité d’un univers en mouvement.
Entre héritage et algorithmes
Le contraste est saisissant : d’un côté, un appareil éditorial figé, efficace pour maintenir son prestige mais refermé sur lui-même ; de l’autre, une réalité culturelle où les lecteurs découvrent leurs livres par des mécanismes de visibilité qui échappent totalement à l’ancien monde.
Archaïsation ne signifie pas disparition. Le modèle de l’édition française, hérité du XIXᵉ siècle — celui qui fit émerger le format du roman comme genre dominant, qui consacra l’industrialisation de l’imprimé, qui érigea le mythe de l’écrivain maudit en figure centrale — fut une révolution en son temps — au grand dam de l’Église, qui voyait dans le roman ou la presse une menace pour l’ordre moral. Il continuera d’exister, comme Canal+ continue d’exister malgré Netflix. Mais il le fera en position défensive, répétant des réflexes hérités plutôt qu’en inventant des formes neuves.
La bataille ne se joue pas entre la pureté d’un héritage et la barbarie d’un intrus, mais entre deux régimes d’autorité : l’un symbolique, figé dans ses institutions, l’autre algorithmique, fluide et invisible. Et peut-être conviendrait-il de s’interroger sur ce qui, au fond, heurte le plus le monde des lettres : est-ce réellement la transformation technologique, avec son cortège de mutations rapides et d’outils nouveaux, ou n’est-ce pas plutôt, plus secrètement, la démocratisation même de l’écriture, l’irruption d’êtres venus d’ailleurs que des cénacles consacrés, qui publient sans permission et se proclament écrivains sans avoir reçu, comme autrefois, l’onction discrète mais décisive de ceux qui s’arrogeaient le droit d’adouber ? Ainsi, ce qui se dit combat contre l’algorithme n’est peut-être, sous ses airs indignés, que regret d’avoir perdu le monopole d’une consécration, jadis tacite mais incontestée. Tant que l’édition française persistera à confondre ce prestige patrimonial avec une influence réelle, elle s’archaïsera toujours davantage, abandonnant à d’autres le soin de décider, en silence, de la lecture du futur.
À lire aussi
Fentanyl : paradis artificiels et déclin spirituel
Marche ou crève : critique du survival dystopique de Stephen King

Zola Ntondo
Éditeur en chef